JEAN DE
SAINT-PRIX
(1896-1919)
Jean de Saint-Prix
« On mourra seul, dit
Pascal. Du moins peut-on emporter avec soi
tout ce que l'on a aimé et laisser derrière
soi le sillage de tout ce qu'on a vécu. »
J. de S.-P.
Il eût aimé Vita, comme son frère l'aime. Il eût goûté notre effort,
l'affection qui nous unit tous et nous permet de travailler ensemble. Il aurait joint sa surprenante
activité à la nôtre. Nul conditionnel n'est plus
décevant ni plus triste que celui qui doit se terminer par cette petite phrase : s'il n'était
mort.
Silhouette frêle, tête un
peu penchée, beau visage, regard lumineux et franc, Jean de Saint-Prix est mort le 18 février
1919, dans sa vingt-troisième
année. Je tenterai de raconter ici sa brève existence, telle qu'elle apparaît à travers ses lettres. Je
n'ai pas craint d'être grand
citateur. Ce récit n'est qu'une mosaïque exécutée pieusement.
L'enfance de Jean de
Saint-Prix fut heureuse. Entouré de tendresse, guidé avec science, il grandit tranquille,
chérissant le travail et la musique. « A
cinq, six ans, dit-il, ma mère me jouait Lohengrin et je me promenais dans des palais enchantés. » Rien, au cours de sa jeunesse et de son
adolescence pourtant délicates, ne vint troubler une vie confiante, promise à toutes les
satisfac-
Voir : Lettres (19 17-19
19), Préface de Romain Rolland (Rieder, éd.), qui viennent de paraître ; Le Pensionnat, pièce
en trois actes en prose (Maison Française d'Art et d'Édition, 1918), et un numéro spécial
de L'Avenir International (Mai 1919), consacré à la mémoire de Jean de Saint-Prix.
tions. « Jusqu'à dix-huit
ans, elle fut une splendide ascension, dans la grande lumière d'une foi humaine, immense,
intégrale. Je croyais
à la fraternité des hommes, je croyais à la vérité, je croyais à la vie. Le monde me
semblait tout proche du but de son évolution. »
Alors, ce monde, objet de
sa candide joie, lui offrit un spectacle : la guerre. « Ce fut un effondrement. Du jour
au lendemain, je
ne crus plus à rien. »
Il faut prendre cette déclaration à la lettre. Jean de
Saint-Prix se trouva désespéré. Il n'admit pas un instant les raisons, trop nombreuses pour être
bonnes, qui furent prodiguées par tous les chefs dans toutes les nations. Il fit sienne, avant
de la connaître,
la formule de Jouve : « Aucune cause ne vaut que je meure et que je tue », et le
prouva.
Parmi des souvenirs qu'un numéro spécial des Humbles, consacré à Guilbeaux, va
publier prochainement, J.-P. Samson rappelle celui-ci : « Un soir, au groupe des Etudiants
socialistes révolutionnaires.
Il y avait parité de voix entre majoritaires et minoritaires, entre guerriers et
antiguerriers. Alors Jean de Saint-Prix, qui assistait à la réunion pour la première fois,
demanda son inscription et, votant
à son tour, nous assurait (à nous minoritaires) la majorité. Sa « voix d'archange », comme nous
disions, imposait silence aux protestations rageuses... »
Il avait pris parti. Il prendra parti toujours, contre toutes les injustices, et ne
cessera de honnir l'injustice supérieure qu'il nomme « le grand blasphème qui
s'accomplit sur le champ de bataille ». Mais son cœur est désolé. La besogne est
immense. Il se voit
seul, sans pouvoir, sans moyens, sans force. « Et un jour vint, avoue-t-il, où je ne fus
plus qu'un désert. C'était en décembre 1914. Il faisait froid. Paris était sépulcral. Le monde
s'engloutissait dans sa damnation. Je crus que j'allais mourir. »
Cependant il travaillait,
au cœur même de sa détresse, soit qu'il préparât une licence de philosophie,
soit que, cédant à sa douleur, il composât des Poèmes pour prouver la vanité de
l'individualisme.
Puis, auprès d'une amie un
peu mystérieuse, dont ses lettres parlent rarement et qu'il semble avoir adorée, il
entrevit un espoir. L'amour qu'il
rencontrait lui donnait à croire de nouveau à la fraternité : elle est possible, elle sera.
Dans les Dialogues
intérieurs qu'il
écrivit à cette époque, « l'Homme est encore dévasté, mais pourtant l'Esprit a repris la
parole ».
«Le Destin veillait et répondit encore.
» Devant la Méditerranée, « par ce printemps
des pays doux », un matin, l'être aimé mourut.
Mais la résurrection de Jean
était accomplie, et celle qui lui avait rendu le goût de vivre ne l'accabla point par sa mort.
Le souvenir qu'elle laissait en
lui était une inspiration nouvelle. Il se retrouva seul, mais pour l'amour d'elle et de sa mémoire, il
lutta.
C'est alors qu'il partit en
Suisse. Dès son arrivée, il adressa à Romain Rolland, l'homme qu'il estimait le plus au monde,
ce court billet :
« Maître, Frère,
«Je suis un jeune Français
de vingt-et-un ans. Je désire profondément
vous voir.
«J'arrive de Paris, où j'ai
vu, il y a quelque temps, monsieur
et mademoiselle Rolland.
JEAN DE SAINT-PRIX.
Licencié ès lettres (Philosophie) Diplômé des études supérieures en
philosophie Délégué au Lycée de Laval.
Romain Rolland l'accueillit
aussitôt. Le jeune homme vécut quelques
jours aux côtés du maître qu'il avait choisi et qui ne le déçut pas. Liberté, vérité, lumière
jaillissaient des paroles du grand
exilé. Lectures, promenades, longs entretiens, réunions de quelques amis au cœur sincère et
haïssant la gloire des armes, tous
ces bonheurs qui avaient paru irréalisables à Jean de Saint-Prix l'entourèrent, l'accablèrent
presque, lui dispensèrent « une joie éblouissante et pleine de sanglots. »
Rentré à Paris, il pénétra
dans le petit groupe de ceux qui demeuraient fidèles à Romain Rolland et qui menaient une
action pacifique. Il était le moins
âgé. Il fut bientôt le guide. « Sa passion de jeune apôtre nous réchauffa, dit Rolland. Et il nous
dépassa. »
C'est un apôtre en vérité,
celui qui prêche : « Mieux vaut laisser souffrir les hommes que leur mentir. » Jean de
Saint-Prix a la haine du mensonge, de
la tromperie, de la lâcheté. « Par-delà toutes les étiquettes, il n'y a que deux races d'hommes :
les véridiques et les menteurs, ceux
qui respectent ce qui est et ceux qui hurlent ce qui devrait être, ce qui est en éternité, ce
qu'atteste toute conscience libre
contre l'Univers entier si l'Univers entier est dressé contre elle. »
Il est philosophe sans
doute, mais non épicurien. La sagesse qui le tient est passionnée, fervente. Elle partagera les
souffrances des hommes si elle n'a pu
contribuer à les leur épargner. Indulgente et bonne, elle se révolte contre tous ceux qui font le mal.
Elle ne se permet pas de subtils
raisonnements sur les intentions. Le résultat seul mérite d'être retenu. Est-on sincère et croit-on
agir bien en agissant mal, il
n'importe : on a mal agi. Maudissons les méchants. « Celui qui maudit par amour ne peut apporter au monde que la paix. »
Des inquiétudes germent
dans l'esprit de Jean, se développent, grandissent. Les temps sont ingrats. La longueur des jours
lui pèse. Est-ce uniquement à
cause du cataclysme qui bouleverse le monde ? Ou s'il éprouve déjà cette faiblesse physique dont
la maladie se fera la
maîtresse ? « Vont-elles se prolonger encore, ces années... »
Le sang de chaque soldat
blessé paraît jaillir de ses veines. « Je ne veux pas, de tout mon cœur je ne veux pas que des balles déchirent la peau de l'homme et
qu'il pleure dans des trous boueux
en attendant la mort. » Et citant Pascal : « Le Christ sera en agonie jusqu'à la fin des siècles. Il
ne faut pas dormir pendant ce temps-là », il
ajoute : « Pourquoi Pascal, autre pharisien, dit-il : Il ne faut pas
dormir ? Ce n'est pas une affaire d'obligation. Naturellement, humainement, on ne peut pas dormir, pendant que l'homme souffre, si l'on sait comprendre sa vie
avec amour. » Il craint que
l'homme ne souffre toujours. Il est sans espérance.
Il croit pourtant à la joie,
à la justice, à la paix, au bonheur. « Je ne crois pas à Dieu, mais au Divin. C'est la même chose
et c'est différent. Dieu,
comme être distinct, ne peut pas être. Mais il est l'infini, l'amour, la vie, qui pénètrent et
animent l'Univers et l'Homme. Toute
expérience humaine qui s'élargit, se purifie, se libère, nous met en contact avec cette région de
notre esprit qui est divine. » Sans espérance et plein de foi.
Il s'est jeté dans l'action.
Les faits l'attirent. Il veut voir clair, combattre le pessimisme qui l'étreint, et agir. «
Rien n'est grand et solide en nous que
ce qui est le fruit de notre effort. » Il collabore à de petites revues que les gouvernements
surveillent et pourchassent, parce
qu'elles contiennent quelques atomes de vérité. Il publie des poèmes, des études, des articles
dans Demain, Les Humbles, La
Forge, L'Avenir International et La Plèbe de
Fernand Desprès. Lorsque celui-ci est jeté en prison, pour «intelligences avec l'ennemi », ou
plutôt pour intelligences avec
l'Intelligence, délit qu'on pardonne encore mal aujourd'hui, Jean de Saint-Prix adresse aux journaux
sa noble protestation. Il est un des membres les plus actifs de la Société d' Etudes documentaires et critiques sur la
Guerre fondée par Gustave Dupin. Il la pousse à aborder les sujets
les plus brûlants. Il devient le
pasteur d'un petit groupe d'âmes. Son émotion, sa délicatesse lui dictent des
paroles uniques. Et peut-être comprend-il, conseille-t-il mieux les autres qu'il ne se comprend lui-même.
Son esprit demeure au-dessus de ses gestes, et voit plus loin, plus haut, ailleurs. Il est la
proie du tragique quotidien et
du tragique éternel. Romain Rolland notait après l'avoir reçu : « Je prévois pour lui bien des épreuves.
» Jean de Saint-Prix les subit toutes.
Une lueur au début de la Révolution russe. Il appelle la Russie : « Notre République de là-bas,
la seule, la première qui est la
nôtre. » Mais les nouvelles détruisent son enthousiasme. « Les Bolcheviks qui m'avaient embrasé,
les voilà qui opposent la force à la force, qui
oublient que celui qui se servira de l'épée, périra par l'épée. Les voilà qui entrent dans la danse
insensée de notre époque et
intensifient l'industrie tueuse d'hommes : la justice n'est plus qu'un mot, s'il lui manque l'humanité. »
Une autre lueur, pour lui, était la paix. Il fallait «
qu'elle vînt du cri des consciences
indignées », qu'elle éclatât un jour comme éclate la guerre et qu'elle opposât à l'esprit
belliqueux un Non farouche, inattendu, inébranlable. Dès le début de 1918, Jean de Saint-Prix devina que la paix ne
serait pas cela. « Ceux qui disent : Assez, et
qu'on écoute, ce sont ceux qui veulent sauver la vie nationale et sociale telle qu'elle est, ou la
réformer sans la rénover vraiment,
selon les directions désuètes qu'elle offre, toutes tracées. » Il fait ailleurs cette prédiction :
« Le jour où la paix reviendra,
elle ne sera pas notre œuvre, à nous. Un pacifisme officiel surgira juste à temps et revendiquera l'honneur de la tardive réconciliation
des peuples. »
Et Jean de Saint-Prix retombe dans la nuit.
Son seul bonheur alors :
ses amis, et leurs œuvres. Ce sont d'abord les œuvres qu'il découvre. Lit-il un livre qui le
transporte d'enthousiasme, parce qu'il
y rencontre l'expression de ses propres rêves et de ses passions, il écrit le jour même à l'auteur,
au frère inconnu, et avec une
si ardente franchise qu'il force les plus rares amitiés. Le frère inconnu devient rapidement un
véritable frère.
Les lettres de Jean sont longues, et il s'excuse de leur
longueur. Réjouissons-nous de ce qu'il
regrettait : sans elles nous ne saurions pas quel
il fut. Son œuvre est peu importante et ne le reflète qu'imparfaitement. Seules, toutes ces lettres le font revivre avec nous.
On y trouve l'analyse de ses lectures, de quelques-uns de
ses projets. Ce qu'il fera, ce
qu'il écrira, plus tard... ce qu'il n'écrira jamais. Il
étudiera la technique
musicale. « On ne comprend intégralement un art que lorsqu'on en connaît le métier. » Il
entreprendra, « dans bien des
années peut-être, une Histoire des Peuples, comme on n'en a jamais fait : une histoire qui
dirait la vérité et qui montrerait le
Calvaire de l'Homme, de façon à l'empêcher de se laisser reprendre sans cesse à de menteuses
fois politiques ». Il lit et
relit Pascal, Vigny qu'il sait par cœur, Platon, Spinoza, « large mais rude », Romain Rolland, André Spire. Il découvre les poèmes de
Tagore. Un mois avant de mourir, il est plongé dans
les poètes anglais.
On y trouve aussi des confidences, des pensées, des raisonnements que tout être de bon vouloir
devrait méditer. Avec cela, une
pudeur sans exemple. Crainte d'exprimer trop, de paraître divaguer, d'analyser en vain ; crainte
de n'exprimer pas assez, de sembler
froid, de tromper la confiance. La fin des lettres est brève, sans recherche, sans émotion. «
Tout à vous. » « Au revoir. » «
Je te serre la main. » Mais la poignée de main est franche, forte et douce.
Pour chaque ami, c'est une attention particulière, un jugement précieux, un hymne de l'affection.
Ils le savent bien, Romain Rolland, Martinet,
Desprès, Dupin, Masson, Debrit, qui ont perdu avec Jean de Saint-Prix le plus sincère et le plus
fougueux des défenseurs.
Quelle définition de Romain Rolland vaudra celle-ci « Vous avez le malheur béni de ne parler qu'aux
âmes et d'être inapte aux
pantomimes qui se jouent sur nos tréteaux ?» Quelle critique d'Empédocle d' Agrigente atteindrait à la valeur d'une des lettres adressées à Rolland et qui formerait une
surprenante préface ? Et mille
autres choses...
« Pourquoi a-t-on des corps ? »
demandait Jean de Saint-Prix. Un soir d'hiver, au sortir d'une
réunion, Jean et son frère furent saisis par le froid et la neige.
La fièvre les prit. Jean résista, et dut pourtant se coucher. Il écrivit à un ami une petite
lettre. Ce fut la dernière : «
Pierre a la grippe. Moi, simple rhume ; pas raison de s'en faire. Jean. » Il reprenait courage.
Débarrassé depuis quelques mois du
souci abominable de la guerre, il avait entrepris de nouvelles tâches. Quelques jours plus tard, il
était mort.
CLAUDE AVELINE






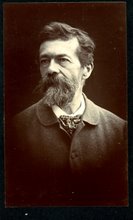














Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire