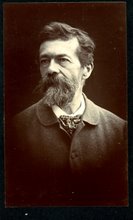L'AVENIR INTERNATIONAL
Revue Mensuelle d'Action Sociale, Littéraire, Artistique, Scientifique
TIRAGE A 100 EXEMPLAIRES, HORS COMMERCE
Numéro consacré à la Mémoire de JEAN DE SAINT-PRIX
JEAN DE SAINT-PRIX
SOMMAIRE
1. Contre les âmes libres de France …... Jean DE SAINT-PRIX.
2. A notre jeune frère ........ Romain ROLLAND.
3. Jean de Saint-Prix et nos Jeunesses Rouges …..Emile CHAUVELON
4.L'Internationalisme de Jean de Saint-Prix . . . . Gustave DUPIN.
5.Un souvenir................................................. Charles RAPPOPORT.
6.Souvenirs ......................................................... Edouard ROTHEN.
7. Jean de Saint-Prix .......... Marcel MARTINET, Joseph BILLIET, Fernand DESPRES
8. Paris fleuri de Rouge ..........................................Joseph BILLIET.
RÉDACTION ET ADMINISTRATION :
96, Quai de Jemmapes -:- PARIS (10e)
Inconséquence et Iniquité
Notre ami J. Béranger a été condamné à un an de prison, tandis que Content a été acquitté — ce dont nous ne pouvons que nous réjouir — et Rigault condamné à trois mois.
La condamnation de Béranger est due très vraisemblablement à l'attitude intransigeante qu'il a manifestée au cours du procès.
Cette différence de traitement suffirait à démontrer ce que vaut la justice des juges qui jauge les sanctions non suivant l'acte incriminé, mais suivant la satisfaction ou le désagrément que l'inculpé, par sa tenue, procure à ceux qui le jugent.
Mais ce n'est pas là surtout ce que nous voulons relever.
Béranger a été condamné pour avoir imprimé des lettres de Sadoul et des brochures que la censure n'avait pas approuvées.
Or, depuis, et quelques jours seulement après la condamnation de Béranger, un journal, qui devait s'appeler Le Bolcheviste et qui, sur le refus de la censure de lui laisser prendre ce nom, parut sous le titre: Le Titre censuré!!!, journal bolcheviste, a publié, évidemment avec le visa de la censure, certains des écrits qui avaient valu à Béranger sa condamnation.
Alors ?
Désormais le maintien de Béranger en prison devient une absurdité et une injustice criante. S'il est permis d'imprimer une chose dans un journal, il ne peut être défendu de l'imprimer en brochure ! Et une condamnation pour ce dernier fait n'a plus aucune valeur.
L'autorisation gouvernementale octroyée ultérieurement, efface du même coup le caractère délictueux qui lui était imputé auparavant.
Pour la logique, pour la justice la plus élémentaire, nous réclamons la mise en liberté immédiate de Béranger.
Que les journaux socialistes, libertaires et syndicalistes s'unissent à nous pour exiger cet acte de simple bon sens et de stricte équité !
L'AVENIR INTERNATIONAL.
Contre les Ames libres de France (Ecrit sans doute à la fin de 1917 ou au début de 1918).
Des voix libres se sont élevées, claires et puissantes, au cœur même des nations soumises à la loi du sang et à la Raison d'État : Liebknecht en Allemagne, Adler en Autriche, Morel en Angleterre, Lénine en Russie. En France, personne. Romain Rolland est en Suisse, et peut-être sa place est-elle bien dans ce pays, où viennent déferler tous les courants intellectuels du monde.
Mais parmi ceux qui sont ici, parmi ceux qui ont vécu une à une les heures funèbres de ces trois ans, aucun n'a émis au grand jour une parole de fraternité et de vérité. Pourquoi ? Ils existent, pourtant, ceux qui auraient pu parler, ils sont nombreux, je les connais. Et ils se sont tus.
Ils invoquent la censure, l'interdiction des réunions, toutes sortes de difficultés pratiques qu'ils déclarent insurmontables. Je leur réponds par les exemples cités plus haut. La vie doit être inventive et créatrice. Une pensée comprimée doit se façonner elle-même une autre issue, et son apôtre doit savoir courir tous les risques et affronter taus les sacrifices, pour culbuter tous les obstacles.
Aucun Français, sur le territoire de la France, n'a eu le courage d'entreprendre un apostolat et l'habileté d'y réussir. C'est un fait, personne ne peut le nier. Des bonnes volontés existent, des velléités se sont dessinées. Mais la timidité et même l'échec sont un crime lorsqu'il s'agit de choses aussi graves et aussi urgentes.
Non que j'attache une importance quelconque à la nationalité des hommes libres. Je suis aussi fier d'Adler et de Lénine que s'ils étaient Français. Car, c'est au nom seul de l'humanité que l'on peut éprouver une telle fierté. C'est une raison autre qui me fait dénoncer comme un crime, le fait qu'aucune voix forte et nette ne soit parvenue à triompher de la conspiration du silence.
Serrés dans l'étau de nos frontières hérissées de baïonnettes, confinés dans l'atmosphère raréfiée d'une nation, il existe, ici comme par tout l'Univers, épars au milieu des fous et des barbares, quelques esprits lucides, quelques cœurs pitoyables. Il existe des mères, des soldats, des enfants, des travailleurs qui n'ont pour toute âme que leur conscience d'hommes. Et alors, ceux-là, en les privant .par votre silence du frère autour duquel ils se seraient groupés et qui aurait parlé en leur nom, vous les avez trahis, vous les avez crucifiés.
Représentez-vous l'agonie morale qu'aura vécue pendant ces trois ans, celui qui n'aura pas été emporté par la rafale nationaliste et guerrière, et qui était trop faible et trop humble pour ne pas s'anéantir en lui-même, et voilez-vous la face. Pour atteindre les âmes nobles et douloureuses, on trouve toujours une voie, lorsque l'on cherche avec ferveur. Mais vous étiez des hommes de peu de foi, et vous vous êtes crus quittes quand vous vous êtes groupés, un certain nombre, et que vous avez dit : « Nous ne pouvons rien » Malheureux ! Dans quel abandon vous laissiez les pauvres dispersés qui vous appelaient, et qui, peut-être, étaient plus sincères encore que vous ! Vous ne compreniez donc pas que vous étiez des pharisiens ? Votre orgueilleux et sombre isolement, votre joie pessimiste et pascalienne de n'agir que par des voies souterraines et restreintes, n'ont rien à envier aux reniements de tous les renégats qui mettent en croix l'idéal dont ils étaient les prêtres.
Jésus a dit que les vertus et les vices étaient les mêmes à Jérusalem et à Samarie. Il n'y a donc point de chrétiens en France ? Voltaire a ri de la tragi-comédie, qui met les hommes aux prises pour des malentendus. Vous qui ne savez pas pleurer, vous ne savez donc pas rire non plus ? Romain Rolland, nous a montré par un roman en dix volumes, qu'un Allemand naît, vit et meurt. Monsieur de la Palisse se serait écrié : « Bravo! J'ai compris ! » d'une voix si forte que tout le monde aurait entendu ; il n'y a donc pas un Monsieur de la Palisse parmi vous?
La vérité, c'est que vous avez effectivement fait un effort, mais que vous admettiez de prime abord que les résistances triompheraient de vous. Si votre désespoir et votre foi avaient été vivants et animés par un souffle d'apostolat, vous auriez soulevé des montagnes. Ce que vous deviez dire était si simple, si nu, si transparent ! Qui n'eût pas compris? Et qui eût pu vous empêcher de prononcer la parole d'amour que chantent la poésie des choses et le gazouillement de l'enfant, ou la parole plus mâle qui fait frémir au fond de l'être, le séculaire esprit révolutionnaire? -
Si vous aviez eu la foi, vous auriez parlé et l'on aurait compris. Mais vous n'aviez pas la foi.
Mais alors, d'autres n'auraient-ils pas dû venir d'ailleurs ? (1) En Suisse, en Espagne, on parlait, oui. Mais pendant ce temps, la France restait une prison, patrie sans porte ouverte vers les autres patries, — hélas ! les patries sont des tombeaux! — sans contact avec l'Esprit, avec le Coeur uniques qui tressaillent par l'Univers et l'emportent de l'éternité à l'éternité, sans qu'aucun homme, — et tous, pourtant, sont les dépositaires de cet Esprit et de ce Coeur, — par-delà les barrières matérielles, n'ouvre assez largement en lui l'écluse, pour que la vérité d'Amour et d'Indignation se rue et déferle sur tous.
Et maintenant, vous, les vrais libres et les vrais humains qui vous êtes tus ici ou qui n'êtes pas venus d'ailleurs, pensez à vos victimes. Vous aurez peine à les compter dans le monde des âmes ; et dans le monde des corps, vous verrez
(1) Je ne parle pas de ceux qui ont vraiment un rôle à l'étranger, et qui, comme Rolland ou Guilbeaux, y livrent un combat fécond, mais de ceux qui s'y sont « réfugiés ».
qu'elles sont aussi nombreuses qu'il y a de morts sur tous les champs de bataille, puisque tous ont été tués avec votre consentement implicite. Alors, qu'est donc votre liberté, qu'est votre humanité ? Elles ont tout juste la valeur d'une restriction mentale! Dérision!
Car, lorsque la réalité de la vie et de la mort sont en jeu, la réussite seule prouve la valeur des convictions. Après un naufrage, donne-t-on la médaille de sauvetage au prêtre qui récite des prières pendant que le bateau. coule, ou aux matelots qui mettent les barques à la mer ? Elle est trop commode, la -morale de l'intention ! Est-elle plus efficace, après tout, que le hautain mépris du stoïcien?
Il y a ceci encore en vous. Commençant par admettre que les résistances triompheront de vous, vous finissez par vous en amuser. Plus vous êtes persécutés, plus vous croyez avoir de mérite, et plus vous êtes fiers de vous sentir différents des autres. Alors, pour vous prouver que vous ne pactisez pas et que vous tentez tout, vous vous répétez à satiété : « J'ai eu tant de lignes censurées... J'enverrai cela en Suisse... J'y renonce, ce n'est pas de ma faute... Comptons sur la Révolution Russe, sur les Italiens... » Pourquoi pas sur les Peaux-Rouges? Croyez-vous donc que ceux qui sont ici, tout seuls, et qui voient la réalité présente sans promener leurs rêves aux quatre coins du monde, croyez-vous qu'ils puissent attendre et se contenter de vos raisons ?
Oh! Assez étouffer ! Proudhon disait : « Je suis une voix d'honnête homme qui crie dans le désert! » Il y a des honnêtes gens, ici. Pourquoi n'entend-on pas leur voix ?
Vous vous demandez pourquoi on n'a pas entendu la mienne? Parce que, lorsque la guerre a éclaté, j'étais presque un enfant, parce que j'étais aussi parmi la troupe obscure de ceux qui attendaient un Messie, parce que cela m'a trop désespéré pour que je sois ce Messie.
Vous qui êtes plus forts que moi et qui n'avez rien dit, est-ce que vous n'aurez donc jamais de remords? Insensés, qui n'avez pas agi comme si un Christ était caché au fond de chaque homme, et comme si votre âme, ainsi qu'elle devra le faire à sa dernière heure, portait un jugement définitif sur les actions de votre vie!
Insensés, qui ne savez pas que l'on est bon et vrai à la seule condition de croire en la dignité de l'homme et d'être prêt à mourir avec sérénité ! Jean De SAINT-PRIX.
A NOTRE JEUNE FRÈRE
Maintenant qu'il nous a quittés, nous pouvons dire l'amour que nous avions pour lui.
Il nous était apparu comme un jeune prince de Shakespeare, un poétique adolescent, toutes les forces de la vie et de la mort luttant en un corps frêle : tendresse et ironie, don du rire et des larmes, soif de se dévouer, ardeur de tout comprendre, besoin chevaleresque de courir au secours des opprimés, d'offrir sa poitrine aux coups qui leur étaient destinés, passion brûlante de la vie et désespoir passionné du néant... Cette âme remplissait tous les étages de sa maison, de la base au faîte...
Qu'une fleur aussi pure ait surgi du milieu des tristesses, des bassesses de ce temps, c'était comme un miracle. Et ceux qui en furent témoins, d'abord un moment incrédules, en concevaient ensuite un sentiment d'amour presque religieux. C'était, une chose touchante de voir ces hommes âgés, sceptiques ou révoltés, tannés par la dure, l'amère expérience, qui devant ce cadet s'inclinaient avec un tendre respect, tant est rare la lumière, et puissant son attrait sur les coeurs qu'enveloppent les brouillards méphitiques d'un monde agonisant.
L'étoile a disparu, mais sa lueur persiste dans les yeux qui l'ont vue. Et nous continuons de suivre sa trace au fond de la nuit. Maintenant, il est au but, notre jeune compagnon, il a d'un bond atteint le terme où nous arriverons tous. Et moi, qui ne prie guère, j'éprouve le besoin, parfois, de m'entretenir tout- bas avec notre petit frère, et je lui dis :
« Maintenant, conduis-nous ! Tu es maintenant notre aîné. »
Romain ROLLAND.
souvenir
Jean de Saint-Prix est venu me voir un jour en se présentant lui-même, sans mot d'introduction. Il m'a plu de suite. Plus. Il m'a produit l'impression d'une nature supérieure. Et je l'ai prié de me faire l'honneur de son amitié. Au moment de la révolution bolcheviste, mon attitude critique au sujet de la dissolution de la Constituante et de la terreur le révolta. Il m'a écrit une lettre violente en demandant de la publier dans. La Vérité. Je remis la lettre au directeur de ce journal, en déclarant que je ne m'opposais pas à sa publication. La sincérité de Saint-Prix fut si évidente, sa violence eut des motifs si nobles que nous restions en rapports cordiaux. Et je dois à sa mémoire et à la vérité d'avouer qu'il n'avait pas tout à fait tort en me disant que notre devoir est non de souligner ce qui nous sépare, mais ce qui nous unit, nous et la grande révolution bolcheviste. Et si je me suis conformé depuis un an à cette tactique, je le dois un peu à Saint-Prix. Merci, cher et regretté camarade !
Charles RAPPOPORT.
Jean de Saint-Prix et nos Jeunesses Rouges
Nous regrettons amèrement Jean de Saint-Prix. Il représentait une de nos plus chères espérances. Il eût été un guide précieux pour la jeunesse héroïque dont a besoin l'élaboration des temps nouveaux.
Mais il n'est pas mort tout entier. Il survit dans son œuvre. Et cette œuvre c'est, en outre et au-dessus des pages délicates, fines et ardentes qu'il a écrites, l'exemple même de son activité, tout entière consacrée au plus pur des idéals humains.
Son grand cœur acceptait sans hésitation et sans réticence le devoir de fraternité et de sincérité qui sera le salut de l'humanité si douloureusement éprouvée. Ou plutôt, pour mieux dire, l'âme de Jean de Saint-Prix était ce devoir même. Ce devoir était sa vocation naturelle et sa vie.
Nous ne dirons pas qu'il « allait au peuple ». C'est une expression orgueilleuse, fausse, et d'ailleurs depuis longtemps périmée.
Il allait droit à la vérité intellectuelle et sociale, droit à la beauté littéraire, esthétique et morale.
Sa fine nature sentait à merveille combien la vérité sociale est élégante et belle. Et son sens critique, très averti, très sagace, n'avait pas de peine à le convaincre que la prétendue élégance qui repose sur le mensonge social et sur l'institution d'une classe privilégiée et exploiteuse, est factice, menteuse et vile.
Il vivait dans la parfaite et calme lumière de la raison et de l'art.
Mais par respect et par amour pour cette lumière, il combattait tout ce qui est ténèbres et mensonge. Il militait non par haine, mais par scrupule de sincérité, par passion de la vérité. Il militait par délicatesse. Sa sincérité, sa logique, sa générosité, son désintéressement l'avaient porté à l'extrême gauche de nos « Jeunesses Rouges », dans le groupe des étudiants socialistes et internationalistes révolutionnaires.
C'était parfait. L'héritier intellectuel des La Boétie et des Vauvenargues ne pouvait être à sa place que là, et nulle part ailleurs.
Et c'est là, sur ce champ de bataille volontairement choisi par lui, qu'il contracta la maladie dont il est mort. Sa frêle santé, qui l'avait fait si légitimement réformer, ne put pas résister à la fatigue d'une de ces réunions « privées » que nos Jeunesses Rouges sont obligées de tenir dans des locaux misérables et insalubres, à cause de la modicité de leurs ressources, à cause, surtout, des persécutions policières et gouvernementales.
Ainsi Jean de Saint-Prix est mort, pour ainsi dire, en pleine action. Il est mort de cette action, mort de son dévouement.
Il est mort surtout de son grand coeur. La pensée de la guerre le torturait. Cette discrète, mais âpre et profonde douleur le minait sourdement. Cette préoccupation était, pour son exquise sensibilité, pour la finesse et l'élégance de sa raison, pour la délicatesse de son organisme, un supplice de tous les instants.
Et, d'autre part, il n'avait point encore cette maturité d'âge et de talent qui permet aux Romain Rolland et aux Barbusse de se consoler en écrivant des livres accusateurs et vengeurs, et en créant d'impérissables chefs-d'oeuvre.
En toute vérité, l'on peut dire que Jean de Saint-Prix est mort de la guerre, mort de la mort des autres.
Les jeunes gens qui lui survivent, les jeunes socialistes internationalistes révolutionnaires le vengeront en jetant à bas l'édifice économique et social d'exploitation, de mensonge et de haine pour qui l'âme exquise de Jean de Saint-Prix éprouvait un si parfait mépris.
Jean de Saint-Prix vivra dans leur mémoire.
Dans les heures d'amertume, dans les jours d'épreuves qui très .certainement les attendent, son souvenir brillera comme une lumière dans la nuit. La douceur de son âme, toujours présente en eux, adoucira les inévitables souffrances.
Et en méditant sur la rectitude absolue de sa pensée et de sa vie, ils prendront en haine et en dégoût ces demi-vérités par où échouent les révolutions, et par où périssent les meilleurs et les plus purs de «ces hommes vraiment fraternels qui se dressent comme les statues magnifiques du droit et de devoir». C'est Barbusse qui, dans Clarté, les définit ainsi.
Jean de Saint-Prix eût été un de ces hommes-là.
Il est mort en vue de la terre promise. Mais la jeune génération qui surgit, et qui s'est révélée récemment le jour de la manifestation en l'honneur de Jaurès, conservera à sa mémoire, le pieux et tendre respect qu'on doit aux précurseurs prématurément ravis.
Emile CHAUVELON.
—————————
SOUVENIRS
Mon cher Fernand Desprès m'avait dit, dans des lettres pleines d'émotion, quel frère de pensée, quel ami affectueux il avait rencontré en Jean de Saint-Prix. Il m'avait raconté avec quelle ardeur et quelle flamme ce jeune homme, qu'une situation sociale privilégiée invitait à une carrière bourgeoise, égoïste et féroce, avait épousé la cause de l'humanité contre la sauvagerie et voulait servir l'intelligence et l'amour contre l'imbécillité et la haine.
Quand, il y a un an, des persécutions odieuses atteignirent Desprès, que, sans motif, il fut jeté en prison, traqué, diffamé par des mouchards et que des plumitifs serviles s'efforcèrent d'échafauder contre lui une accusation que les policiers n'avaient pu arriver à mettre sur pied, Jean de Saint-Prix fut un des rares hommes qui prirent publiquement la défense de notre ami. Il le fit courageusement, à défaut de tant d'autres, dont le silence fut une lâcheté, plus qualifiés parce qu'ils connaissaient Desprès depuis plus longtemps et savaient mieux que personne sa vie simple, non seulement insoupçonnable mais exemplaire, dans l'isolement d'une conscience scrupuleuse et hautaine. Mais qu'importe le sort d'un honnête homme restant volontairement solitaire et pauvre pour demeurer propre, à des gens, à la foule des gens, que la soif de notoriété et de pécune écarte peu à peu de tous scrupules ? Il faut être promu à l'admiration des badauds, être un cabotin ou un rastaquouère, un « as » de la politique, de l'art, des sports ou de la guerre, ou encore un distributeur de sportule, pour intéresser ces ambitieux. Pour ces « surhommes à la manque », qui, indifféremment, pourront devenir ministres ou aller au bagne, un honnête homme est un être inférieur.
Jean de Saint-Prix défendit Desprès avec tout l'élan de sa jeunesse et surtout avec la confiance absolue qu'il ne pouvait se tromper quoi qu'en pussent dire les augures policiers. Il est des rayonnements et des certitudes dont les consciences fausses ne peuvent donner l'illusion ; il est des élans que seules peuvent avoir les âmes pures et qu'aucune hypocrisie ne peut simuler : Desprès et Saint-Prix étaient deux belles âmes qui devaient se comprendre, s'aimer, et qui ne pouvaient se tromper mutuellement.
... Nous ne nous sommes vus qu'une seule fois. C'était en août dernier, à Montélimar. Saint-Prix était venu m'attendre à l'arrivée du train. Notre poignée de mains et notre conversation furent immédiatement celles de deux amis. Par-delà les distances, nous étions unis depuis longtemps par une révolte, une douleur, des rêves et des espoirs communs.
La journée était chaude. Dans le jardin public où nous nous promenions des odeurs de buis embaumaient la lourdeur de l'air. Les seuls bruits venaient de la gare toute proche. De malheureux oiseaux exotiques, dont une grue couronnée qui ressemblait à une femme à la mode marchant sur des talons trop hauts, s'ennuyaient dans des cages. Quelques personnes somnolaient sur des bancs, ne s'ennuyant pas moins, et ces gens, comme le jardin, comme les oiseaux, comme toute la ville, semblaient loin de la vie, loin de toute humanité.
Jean de Saint-Prix gémissait sur les existences pétrifiées des sous-préfectures, sur leur absence de pensée personnelle, leur entêtement solide dans des préjugés dont la masse effrayante semble braver le temps et devoir éterniser la misère du monde. Le mensonge de ces préjugés n'avait-il pas réussi à déclancher le plus épouvantable des crimes ? Contre ces forces mauvaises plongeant leurs racines dans vingt siècles de sottise routinière, qu'avaient pu faire les espoirs de vie nouvelle péniblement édifiés ?
Les grands principes étaient-ils autre chose que des formules «destinées à bercer l'impatience des hommes voulant aller de l'avant ? Liberté, justice, amour, sont depuis toujours des aspirations auxquelles le mensonge donne journellement un travestissement nouveau pour les faire servir à ses fins : caché derrière elles, il abuse les pauvres hommes qui, trop souvent, ne demandent qu'à être abusés. Devant la catastrophe, tous les grands principes avaient été emportés et, avec eux, les groupes humains qui devaient être leur appui : organisations politiques, économiques, religieuses, artistiques, avaient perdu toute signification universelle et humaine pour devenir nationalistes. Le cercle étroit des patries s'était fermé sur l'universalité des âmes, et le citoyen avait tué l'homme.
Ceux qui voulaient demeurer des hommes étaient restés seuls, suspects et menacés ; la solidarité humaine sombrant n'avait plus de refuge que dans les consciences choisissant des solutions individuelles. Que devaient faire ceux qui ne voulaient pas participer au crime ? Chacun devait agir personnellement, selon les circonstances, suivant ses possibilités particulières. Jean de Saint-Prix aurait refusé de porter un fusil ; il serait allé, dans ce refus, jusqu'au sacrifice de sa vie. Il n'aurait pas été guidé en cela par l'obéissance d'un Tolstoï à la loi chrétienne : il aurait accompli simplement son devoir humain, suivant le libre choix de sa raison et de sa conscience. Dans un parfait équilibre de ses facultés, il jugeait que les opinions doivent se résoudre en actes : internationaliste, il n'aurait pas fait la guerre des patries ; révolutionnaire, il aurait fait la révolution.
Il avait appris qu'un prêtre avait prêché contre R. Rolland et contre les pacifistes. Il était allé le voir pour protester et pour lui demander comment il pouvait concilier le nationalisme et le bellicisme qu'il manifestait avec l'enseignement du Christ. Et le prêtre, à bout d'arguments, avait fini par répondre qu'il était plus patriote que chrétien !
Que pouvait-on espérer ? L'humanité se dévorerait-elle ainsi toujours ? La dignité d'abord, l'amour ensuite, ne régénéreraient-ils jamais les consciences, et les progrès sociaux ne seraient-ils toujours que de nouveaux blanchiments d'un sépulcre? L'homme n'irait-il pas, enfin, vers l'avenir en se donnant librement à la vie, et en abandonnant derrière lui tous les cortèges de mort du passé?
Une grande lumière s'était levée du côté de l'Orient et éclairait les jeunes espoirs. Tolstoï avait dit aux peuples comme aux individus : « Le Salut est en vous! », et des peuples paraissaient l'avoir compris et vouloir briser les chaînes de leur servilité. Pouvait-on espérer la propagation de l'incendie libérateur? Pouvait-on être optimiste? Oui, on devait l'être de toute son âme, de toutes ses forces.
Malgré tout, la vie est plus forte que la mort. L'humanité vit dans le mensonge et le crime, mais elle vit, et elle porte en elle des forces de rédemption. En elle rayonnent toujours des hommes qui sont l'Esprit, c'est-à-dire la Justice et la Vérité. Ils ne sont pas nombreux, mais ils ont une puissance invincible, celle de l'Idée qui ne meurt pas et qui fondera peut-être une humanité abondante en sagesse.
C'est une loi naturelle observée par Elisée Reclus que, malgré toutes les calamités, il y a une masse de bien supérieure à celle du mal : l'effort humain ira peut-être un jour vers ce bien.
Et même, si l'humanité devait tourner à jamais dans un cercle d'infamie, nous devrions encore rester optimistes pour nous-mêmes, pour la possibilité d'une vie que nous ne voulons pas chargée de dégoûts, pour notre gloire intime, pour notre fierté. Même las, accablés, notre optimisme ne doit-il pas s'alimenter de cette expérience, qu'il est plus facile et moins fatigant de faire de bonnes actions que des mauvaises, d'être un brave homme que d'être une fripouille, sans compter la sérénité qu'on en retire et qui a un prix incomparable pour qui a tant soit peu le respect de soi-même.
... La nuit était venue. Dans le calme plus pur du soir, nous évoquions, de Socrate à Tolstoï, de Rabelais à Shakespeare, à Beethoven, ceux qui, dans la beauté et dans l'amour, ont fondé les raisons éternelles de l'optimisme humain. Une grande douceur et une foi ardente nous pénétraient. Nous sentions qu'une infinie miséricorde pourrait descendre parmi les hommes et les faire meilleurs, par l'effort de tous ceux de bonne volonté.
Voilà les souvenirs d'une rencontre avec Jean de Saint-Prix. Une soirée récente m'a rappelé encore, bien à propos, son indignation du refus opposé par les professionnels de la musique, boutiquiers d'art, à l'exécution à Paris de la Neuvième Symphonie de Beethoven (1). Un grand pianiste lui avait dit que ce serait de l'indécence !...
Or, j'ai assisté à une soirée fort émouvante, réplique de
(1) Ces espèces sont de partout. Je les ai vus, ces professionnels, à Marseille, descendant le buste de Beethoven qui honorait la salle des concerts et refusant de jouer la musique de ce « boche », mais jouant sans remords celle du surboche Meyerbeer dans d'incessantes représentations des Huguenots, de Robert le Diable, de L'Africaine, etc...
l'intelligence triomphante à la pudibonde imbécillité des marchands d'art, et qui aurait enthousiasmé Saint-Prix.
Par l'initiative d'Albert Doyen, au milieu d'une foule populaire accourue pour communier dans la Beauté, des chœurs, composés de travailleurs réunis pour leur propre joie, chantèrent le final de cette Neuvième Symphonie ; et c'était le plus beau cri d'espoir qu'on pouvait entendre.
Il me confirmait ce que nous nous étions dit avec Saint-Prix : la folie des hommes n'est que le résultat du système d'abrutissement auquel les soumettent ceux qui les dirigent. Ce n'est que par une préparation habile qu'on les a conduits à la guerre. Comment pourrait-on dire : « N'oubliez pas! La haine est sainte! » et autres inepties à des foules qui seraient familières dans la compréhension d'un Beethoven? Ce serait impossible, et c'est pourquoi on distribue aux foules la bêtise des cinémas, des music-halls et autres lieux de dépravation intellectuelle et morale, comme on gave d'alcool les malheureux qu'on envoie à l'assaut.
Que le peuple arrive à se débarrasser de tous ses abrutisseurs, de tous les misérables qui n'ont d'efforts que pour l'avilir et le maintenir dan la sujétion ; puisse aller librement vers la Beauté, et il saura alors réaliser sur les ruines du vieux monde abattu, l'œuvre de liberté et de fraternité dont Beethoven a été l'annonciateur mélodieux.
Edouard ROTHEN.
L'Internationalisme de Jean de Saint-Prix
Les esprits véritablement internationaux sont rares.
La grande Révolution bourgeoise, et l'Empire qui lui a succédé, ont formé la société européenne moderne en la pétrissant pour ainsi dire d'une notion exhumée de l'antiquité païenne : la lâtrie patriotique. Cette société, qui fut la nôtre. hélas ! aura duré cent ans environ. Elle est finie, et l'on sait dans quelle sanglante frénésie ! La société nouvelle ne pourra reposer que sur la base internationale.
L'idée de Société des nations est à peine un indice velléitaire d'avenir, un consortium d'intérêts par un compromis temporaire. Le mot nation subsiste ; autant dire Addition de divisions. Ce sont les divisions qu'il faut abolir et non consacrer à nouveau. « Le genre humain est un par essence, dit Lamennais, et l'ordre parfait n'existera, et les maux qui désolent la terre ne disparaîtront entièrement que lorsque les nations, renversant les funestes barrières qui les séparent, ne formeront plus qu'une grande et unique société. »
Les protagonistes des différents projets de Société des nations sont encore enfermés dans la gangue des patriotismes ; il faudra qu'ils s'en libèrent. Ou, plutôt, il en faudra d'autres, qui soient moins Grecs et Romains, et qui veuillent bien consentir à laisser les hommes penser et vivre par et pour eux-mêmes, au lieu de les faire sentir et mourir par Plutarque.
A l'heure actuelle, il semble encore que le plus gros effort de libération, même de ceux qui se disent affranchis, consiste à adopter la ridicule attitude de l'âne de Buridan ; et l'on a ouï au procès Villain des hommes politiques ni chien ni loup, ni chair ni poisson, qui ont proclamé que le véritable internationalisme menait au nationalisme, et aussi que le meilleur national était l'international. Impuissance, hybridité de la pensée. Il y a des personnalités notoires qui traversent la vie en demeurant à l'âge ingrat, et dont l'idéal est une perpétuelle mue. « Quoi ! dit l'académicien quinquagénaire, on a pu douter de mon zèle patriotique et belliciste ! Qu'à cela ne tienne : je vais de ce pas passer le conseil de révision ! » On vous défend la viande, dit le médecin de Montaigne ; ne vous chaille, je vais vous l'ordonner.
Michelet, Hugo, Jaurès, parmi les plus fameux, ont donné de hauts exemples de cette incertitude morale, et c'est un jeu de choisir dans leurs oeuvres des pensées qui se contredisent radicalement sur le point Humanité, Patrie ! Tout récemment M. Barrès a pu, en citant Victor Hugo, prouver qu'il était chauvin ; et l'on a immédiatement pu le démentir en produisant d'autres de ses textes qui prouvent qu'il fut humain ! Triste jeu, car ces pontifes, ainsi que beaucoup d'autres, en révélant leur propre confusion sur un point aussi fondamental, n'ont pas peu contribué à l'épouvantable et burlesque équivoque en vertu de laquelle les hommes qui veulent la vie et la paix, consentent pourtant, sur le signal de leurs diplomates, à la guerre et à la mort !
Les esprits véritablement internationaux sont encore peu nombreux parce que la force de caractère est plus rare que le talent ou le génie. Bien peu ont le courage de confesser avec Tolstoï : « Tous les hommes sont également mes frères ! » Notre Jean a eu cette force. Il avait déjà brûlé l'étape douteuse de l'inconsistance morale, et il se trouvait, à 22 ans, de plain-pied avec le voyant d'Iasnaïa-Poliana. J'en atteste ma chère soeur en Tolstoï, Véra Starkoff, qui a bien connu cet aspect de sa grande âme. Il est venu avec tout son coeur généreux, sa raison limpide et sa profonde culture à l'Internationalisme intégral. On ne peut à la fois diviser et réunir. « Qui n'assemble pas disperse », a dit le grand international Jésus. Il faut choisir. Saint-Prix avait choisi. Qu'il me soit permis, à moi, le doyen de ses intimes, de le proclamer sous le titre de cette publication où il a écrit. Sa mort est une grande perte pour l'avenir humain. Que n'eût-il pas donné ?... Nous cherchons, nous cherchons un caractère de la force de cet enfant !...
Gustave DUPIN.
JEAN DE SAINT-PRIX
(26 Septembre 1896 - 18 Février 1919)
Le 4 août 1914, je n'avais pas tout à fait 18 ans. Tout de suite j'ai été résolument, sans restriction, contre la guerre. Seulement, la chute brusque de mes illusions d'adolescent, ma solitude et la réalité de la guerre, contre laquelle ma révolte ne pouvait rien, m'ont fait souffrir. Alors je me suis tourné vers les choses de l'âme, comme vers un refuge, parce que j'étais trop jeune pour porter cette douleur.
Jean DE SAINT-PRIX.
Oui, il était bien jeune. Bien jeune pour porter la monstrueuse douleur du temps où, plein d'amour et de foi dans les hommes, il s'ouvrit à la vie ; mais en tout temps et en tout âge, sa force eût été inférieure à sa souffrance, parce que cette souffrance, incroyablement désintéressée et riche, était une vocation, et qu'elle rassemblait en lui, avec une puissance passionnée, les plus complexes douleurs du monde.
Vous qui l'avez connu et qui rappelez son corps charmant et frêle, ne laissez pas mourir en vous son image, qui aux plus sombres heures fut l'image de notre jeunesse, et notre clarté dans la nuit. Et vous tous qu'il aima sans vous connaître, avec nous penchez-vous sur son existence et retrouvez en nous la perte que vous avez faite, vous aussi..
On a évoqué l'inclinaison légère de sa tête vers l'épaule, quand il écoutait et qu'il allait répondre ; il est là en effet, dans cette pose familière. Son attention méditative le livre ardemment à la vie extérieure, en un don de soi sans calcul ni réserve, et cependant elle se ferme sur un secret ; ceux qui l'aimaient ont respecté cette pudeur dont il était tout empreint ; ils l'ont trop respectée peut-être, car elle enveloppait les deux pôles entre lesquels il s'est débattu avec une violence qui a contribué à le briser.
Pourtant, qu'il est jeune et clair! En quelque compagnie qu'il fût, nulle fausse timidité d'adolescent, nul embarras ; mais un rien de gaucherie d'enfant, qui donnait à son allure et à toute sa personne une délicatesse féminine et fragile. Le bas de son visage, avec les lèves tendres, le galbe un peu large de ses joues et la rondeur du menton, la fine ondulation de ses cheveux sur les tempes, tout cela et surtout sans doute l'inexprimable pureté qui émanait de lui, le faisaient paraître plus jeune encore qu'il n'était. Mais, comme chez tous les êtres où l'âme est grande, c'étaient ses yeux d'abord qui appelaient, et sa grande âme vierge et frémissante se donnait d'abord dans la lumière de son regard.
Lumière qui ne s'éteindra en aucun de ceux qui l'ont aimé.
Devant elle on ne s'occupait plus de sa jeunesse ; la lumière n'a pas d'âge. Jeunes, certes, ses yeux l'étaient aussi, neufs et caressants comme les yeux de ces tout petits qui l'ont toujours attiré et qu'il a eu l'extraordinaire pouvoir de comprendre ; mais leur profondeur de pensée, leur mystérieuse gravité, leur sérénité, et soudain ces creusements étranges... Non, cette lumière ne s'éteindra pas en nous.
Il parlait. Nos faibles mémoires, que retiennent-elles de la voix de nos morts ? Je me souviens que la sienne était douce et précise, sans chantonnement, d'une sonorité bien posée, avec des inflexions où passaient sa bonté affable et son soin de ne jamais nous peiner. Avec une hésitation parfois, un effort, comme pour s'arracher à lui-même.
La bonté, ce n'est pas la vertu d'un jeune homme de vingt-deux ans. L'aspiration vers la pureté en est une davantage, mais non à ce degré de fièvre qui le dévorait. Quand nous l'avons perdu, beaucoup ont dit, et des hommes faits et de vieux hommes : « Il était le plus pur d'entre nous. » Ce n'était pas une vertu stoïcienne ou chrétienne, qui utilise et sacrifierait l'univers pour croître et s'affiner ; son coeur généreux répugnait aux pharisaïsmes, et d'abord à celui du perfectionnement individuel solitaire. Mais d'un mouvement que rien n'arrêtait, sa nature s'insurgeait contre tout ce qui est corrompu dans l'homme et dans la société, et allait vers tout ce qui est sain, beau et vrai ; par là il a cru à la liberté et à la justice, et il s'est d'instinct trouvé prêt à lutter pour elles.
« Le plus pur. » Nous ajoutions : « Et le meilleur. » S'il chercha cette lutte de même que s'il eut cette compréhension des enfants que je rappelais, c'est qu'il voulait toujours, par nécessité intellectuelle, remonter aux sources de la vie, et c'est qu'il était bon, étonnamment bon.
Il souffrait personnellement de voir souffrir, quelle que fût la souffrance, quel que fût l'être souffrant ; et il voulait souffrir ainsi. Plusieurs fois, il a cité ce mot de Pascal . « Jésus sera en agonie jusqu'à la fin des siècles. Il ne faut pas dormir pendant ce temps-là. » Et ceux-ci de Tolstoï : « Les hommes sont malheureux, ils souffrent, ils meurent ; on n'a pas le temps de flâner et de s'amuser. » Je ne crois pas que quiconque, et pas même Pascal et Tolstoï qui les écrivirent, ait vécu plus intimement que lui l'angoisse tragique de ces phrases. Il n'a pas voulu flâner, s'amuser, dormir. Et lui dont la sensibilité était brûlante, il n'a sans doute haï personne. Son coeur était tout amour.
Je n'écris pas un panégyrique. J'écris un adieu plein de douleur. J'écris à mon ami qui est mort, et pour essayer de dire l'homme que les hommes ont perdu. Cet ami, qui fut le plus véridique des êtres, si je flattais sa mémoire d'un terme qui forçât le moindrement la vérité, ce serait un sacrilège. Alors, si je dis vrai sur lui, on sera surpris non qu'il ait quitté un inonde maudit, mais qu'il ait pu, y vivre vingt-deux ans. Souvent moi aussi j'en suis surpris. S'il a pu y vivre, c'est peut-être justement parce qu'il fut tout amour, et que l'amour le soulevait un peu de terre. Quand il était là, corporellement, comme spirituellement, il nous semblait un peu aérien ; et je pense que lui-même en eut quelque sentiment. Mais maintenant il a disparu, Ariel.
***
Si je dois me briser les ailes, je ne puis le savoir qu'en m'envolant.
Jean DE SAINT-PRIX.
Il croit, il aime ; ses compagnons d'alors se souviennent de son adolescence, de sa pensée déjà puissante, de tant de richesses intérieures qui vont s'épanouir : car voici la jeunesse.
La jeunesse ! « Je n'avais pas tout à fait dix-huit ans... » Et ce fut la guerre.
Il semble que sous ce coup, il y ait eu dans sa vie une rupture affreuse où il douta de tout. Mais cet enfant, au coeur héroïque va faire l'apprentissage des retours éternels entre lesquels il sera écartelé ; son désespoir devant la folie et le crime des hommes lui sera un tremplin pour s'élancer vers une foi plus hardie et plus sereine, et vers l'action.
La conscience de ses aînés fléchit ; parmi les jeunes, les âmes moins bien trempées, les intelligences plus courtes glissent au scepticisme, abdiquent leur destinée, se perdent dans un amour de soi sans issue. Lui, il accepte sa maturité brusquée ; il est sauvé du néant par l'excès même de sa douleur. Et c'est aux jours du crucifiement de l'homme et de la révolution reniée qu'il se donne de toutes ses forces aux grands vaincus.
Cette période, où il s'est le plus dépensé extérieurement, fut sans doute aussi la plus tonifiante de sa vie ; en quelques mois, quand ceux qui avaient juré de veiller dormaient, il aura le temps de remplir une existence militante passionnée, d'ailleurs réfléchie et féconde.
A la plupart de nous, il n'était apparu qu'alors ; et avec la grâce de sa jeunesse et son coeur intrépide, il était comme l'ange de la révolution. Il revenait de Suisse, où il avait rencontré des hommes fidèles. Il en avait rapporté une flamme brûlante ; et il aurait voulu se jeter entre ses frères égarés, et sauver le monde.
Il aurait tout donné, son intelligence, sa santé, sa vie. Il avait tous les courages, et parfois nous tremblions de le voir, lui si pur, dans cette mêlée boueuse où nous sentions qu'il aurait donné jusqu'à son honneur s'il avait jugé que le sacrifice de son honneur était utile. Non qu'il fût inconsidéré ; ce n'était pas une des moindres forces de sa nature, que son enthousiasme fût raisonné, que sous son apparente douceur il eût une sévère volonté de domination de soi, et qu'il calculât avec un sens très ferme ses plus audacieuses initiatives. Mais pour lui, si respectueux de la personne humaine, il n'y avait qu'un être qui, devant la grande misère des hommes ne comptât point, et c'était lui-même.
C'est pourquoi il n'hésitait pas à utiliser son nom dans la lutte, alors qu'il était d'une délicatesse et d'une réserve extrêmes, et qu'il refusait de devoir à son origine aucun avantage personnel. Naturellement beaucoup le comprenaient mal, et même des amis se méprirent devant une modestie et une simplicité qui dépassaient en effet les communes mesures.
Méprise est un terme impropre. La supériorité secrète répandue en lui, on peut croire qu'après une période d'attirance, elle éloignait légèrement ceux qui n'étalent pas dans son intimité immédiate. Cet éloignement faussait leur compréhension ; des hommes qui avaient de la sympathie pour lui ont pu craindre qu'il ne se mît en avant, alors qu'il ne se mettait qu'en premier rang du risque, avec le seul souci d'employer, dans un absolu désintéressement de soi, toutes les armes à sa disposition.
On sait avec quelle bravoure il en usait. Était-il né, lui si fin et si doux, pour cette bataille cruelle? Mais c'est avoir une basse idée de l'action que de la réserver à des lutteurs forains ; là aussi les méditatifs sont les meilleurs, quand la probité et la tendresse du coeur réchauffent en eux la logique de l'esprit. Jean de Saint-Prix entre dans l'action, comme un Aymerillot, sans choisir ses adversaires et sans considération des dangers qu'il courra.
Contre toutes les puissances de haine, d'oppression, d'injugtice, contre les sophismes cérébraux et les lâchetés morales des passifs, contre les tièdes surtout, et jusques contre nous, qui n'avions pas su inventer le salut des hommes... Comme nous l'aimons, de ne s'être pas satisfait de notre pauvre effort!
Ainsi il se multiplie. « Il voulait », écrit quelqu'un qui l'a entièrement connu « accomplir sa destinée et son oeuvre sans se laisser arrêter par rien ni personne. » Et il veut aussi, c'est sa destinée et son oeuvre, donner toutes ses forces, en tous sens, à ce qui lui paraît alors la tâche unique. Nous redoutons parfois cette dispersion. Mais il va ; et nous finissons par comprendre sa calme obstination, nous respectons complètement sa liberté : lui-même il se créera sa discipline, il se regroupera selon sa loi propre... Hélas !
Contre les tièdes surtout... C'est à ceux-là que s'opposait le plus sa nature affamée d'absolu, et il les attaquait avec violence. « Malheur à vous, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes que vos pères ont fait mourir. Vous témoignez assez par là que vous consentez aux actions de vos pères ; car ils les ont fait mourir, et vous bâtissez leurs tombeaux. » Il bataillait à visage découvert, sans se réserver d'appuis, sans ménager personne ; et il préparait contre soi des rancunes solides.
On exploitait ses violences. On rappelait que certains politiciens assouplis avaient été exaltés à vingt ans. Quelle dérision ! La Révolution, lorsque Jean vint à elle, était vaincue et proscrite, et s'il frappait ses serviteurs infidèles ou médiocres, ce n'était que pour la mieux servir, et par amour des peuples assassinés. Qu'avait-il à gagner, aux heures où il criait sa solidarité avec des hommes menacés d'inculpations capitales, à jeter son nom aux Giboyer de l'impérialisme d'affaires, toujours prêts à salir ce qui est beau et pur? Il n'a pas craint cette salissure et il s'est, en effet, mis en avant, chaque fois qu'il s'agissait de soutenir ses amis diffamés ; Guilbeaux, Desprès, il les a défendus avec une ténacité acharnée, comme il devait se défendre, douze jours durant, contre la mort.
**
Moi qui ai aussi donné de la lumière à des humains, pendant que mon coeur se débattait dans l'angoisse et l'incertitude.
Jean DE SAINT-PRIX.
Et il a écrit pareillement : « J'étais faible, et j'ai lutté comme si j'étais fort. »
J'ai parlé de lui. J'ai dit qu'il fut grand et héroïque. Je n'ai rien dit encore. Je n'ai parlé que de ce qu'il eut de plus apparent. Sa grandeur, son héroïsme, les voici.
On a cru voir en lui un jeune homme ardent et sans trouble, que son enthousiasme portait ; on l'a loué de sa foi généreuse que ne traversait aucun doute, et de sa confiance en la vie. Il a vécu avec la mort, il a aimé la mort, et il fut désespéré. Et, c'est avec cela en lui qu'il a lutté, sans un frémissement du visage.
Il n'y a pas de contradiction, mais deux états entre lesquels il a oscillé, qu'il a souvent unis dans une tension simultanée.
Sa vraie lutte est ici ; sa lutte première et fondamentale, celle qui a permis, conditionné, passionné dans son atmosphère grandiose et terrible l'autre lutte, celle que l'on connaît, celle qu'il mena, sans se souvenir de soi et sans trembler, contre le dehors. Cette part secrète de son être, cette part qui n'est qu'une longue douleur saignante et l'âme tragique de son âme, je l'effleurerai seulement, avec toute ma tendresse et toute ma piété ; il n'appartient qu'à lui de révéler ce qui peut en être dit aux hommes : dans le recueil de ses écrits, de ses admirables lettres, ceux qui peuvent comprendre retrouveront sa belle essence ; mais, à cause de ma piété même, à cause de la vérité, je dois entrer dans ce secret.
La vérité. La voilà nommée, celle qui l'a fait si grand et qui l'a tué peut-être.
La vérité est ce que l'on n'accepte pas de l'extérieur comme un apport imposé et subi, elle est ce qui fait partie si intégrante de l'être, qu'en l'affirmant on s'affirme soi-même et que l'on ne pourrait le renoncer qu'en détruisant et en niant sa propre existence. Tous les hommes n'ont pas un égal besoin de vérité, ils ne sont pas également scrupuleux envers cette substance de leur être. Celui-ci ne subit jamais. La conviction, qu'elle lui soit proposée par d'autres ou qu'elle vienne de lui, il ne l'accepte que s'il peut la réclamer tout entière pour sienne, que s'il l'a éprouvée et s'il peut la confesser entièrement. Son aspiration vers l'absolu sera satisfaite ici ; il sera absolument sincère.
Il s'applique donc à faire en soi table rase. Mais non pas avec un détachement cartésien ; à peine peut-on dire que cette attitude soit une critique, tant elle est perpétuellement sous-tendue par une volonté d'aboutir, par une impatience constructive ; et ce n'est pas davantage une besogne une fois faite et que l'on ne recommence plus. C'est une inquiétude permanente et qui pénètre l'ensemble de la vie, affective comme cérébrale, - ou plutôt qui est déjà l'unité même de la vie, car les compartimentages n'ont guère de sens devant cette âme livrée frissonnante à tout le mystère orageux de l'existence, et assez puissante pour ne jamais se refuser au sphinx, pour vouloir au contraire étreindre, contenir tout ce mystère.
Seulement l'amour aussi le possède, n'accepte pas d'être différé, le presse d'agir... Alors, le voilà, ce jeune homme que l'on imaginait porté par les illusions, ce jeune homme qui allait avec sa confiance naïve, droit devant lui, sans soupçonner les obstacles, sans trouble! Entre les deux forces qui le déchirent, que fera-t-il ? 11 ne choisira pas. Mais nous, nous ne verrons que son action ardente, sereine, droit devant lui en effet, nous ne saurons pas qu'elle est le dénouement provisoire d'un drame qui renaît sans cesse et qui l'épuise, et qu'il nous cache, parce qu'il estime que l'individu n'a pas le droit d'affaiblir les autres hommes, proies eux-mêmes de leurs propres sphinx, avec la confidence de ses lassitudes et de ses faiblesses. Oui, découvrant la somme et l'âpreté des douleurs ininterrompues que son sourire couvrait, connaissant que tout ce qu'il nous donna, tout ce qu'il donna à l'action était un triomphe encore saignant sur lui-même et qu'il lui fallait toujours reconquérir par de nouveaux combats, je dis que cet enfant de vingt-deux ans fut un héros.
On serait .tenté de fixer des périodes aux alternatives de sa lutte intérieure. Je crois aussi que dans les derniers mois de 1917 et les premiers de 1918, sa température morale fut à son point le plus haut et le plus favorable, et qu'une dépression y succéda qui a pu amollir jusqu'à sa résistance physique. Mais, c'est une vue grossière. Même ses heures de foi, il les a chèrement achetées, et même au fond du désespoir, il n'a pas cessé de lutter. Quand la mort l'a saisi, il s'est raidi contre elle, ainsi qu'il l'avait rêvé et écrit plus d'une année auparavant, à l'extrême limite de son énergie, et il ne s'est pas rendu.
La mort, qui avait toujours été présente à sa pensée, qui toujours disait le dernier mot, la grande, l'unique victorieuse... Il a composé en face d'elle des pages d'une vérité frénétique, d'un courage sur soi qui est atroce. Je songe à l'âge où elle nous l'a pris, et je ne puis m'arrêter ici plus longtemps. La mort, contre qui, cependant, sa rébellion ressuscitait toujours... Je songe aussi aux malheureux qui ont parlé du dilettantisme anarchiste de ce jeune bourgeois, et aux hommes qui ont voulu la guerre, à la guerre qui a déchaîné en lui toute la tempête. Il a écrit qu'il était faible. Qui de nous aurait supporté cette tempête avec une égale force d'âme ?
Mais l'existence n'est pas tout. Le jour de la mort viendra tôt ou tard. Comme moi, espère dans le grand repos. La certitude de sa venue est la seule chose rassérénante.
Jean DE SAINT-PRIX.
Il n'y a pas que la tempête. Un enfant en qui tressaillaient d'aussi poignantes virtualités, l'horrible veillissement de cette guerre le charge d'une expérience plus pesante que n'auraient fait cinquante années d'âge. Jean de Saint-Prix à vingt-deux ans est semblable au vieux Tolstoï fuyant ses abîmes intérieurs à travers les steppes de Russie. Toutes les espérances se sont flétries entre ses mains, et il aspire à la mort.
Certes, tout son être demeure substance d'amour. Il ne nous a jamais reniés, il n'a jamais renié l'humanité en croix, il n'a jamais renié la lutte. Mais toutes ses interrogations se brisent aux murs de sa prison terrestre, et retombent dans son coeur affamé de certitude comme des ironies désolées.
Je ne blasphémerai pas contre lui. Je crois qu'il y avait en lui tant de grandeur que le grand souvenir qu'il nous a laissé est peu de chose en regard de ce que la mort nous a volé. Je crois que l'habitude de la bataille et de la souffrance n'aurait rien retiré à sa puissance d'aimer, mais qu'elle l'eût cuirassé contre lui-même, comme il l'était déjà contre les incompréhensions et les déceptions extérieures ; et à cause de sa vaillance et de ce qu'il eut d'Ariel, je crois que, de retours en retours, le rude apaisement que porte avec soi la fatigue même de la lutte se serait répandu en lui. Mais, il est vrai que lorsqu'il nous quitta, c'était un temps accablé et obscur. Et il est vrai aussi pour nous que sa mort a paru justifier son plus profond désespoir ; nous sommes plusieurs qui, étourdis sous le coup, n'avons plus alors retrouvé de sens à la vie. Jean n'est plus parmi nous. Il ne sera plus ici pour nous. D'où reviendra notre lumière ?
Et cela reste vrai. Pour notre peine sans consolation, ce qui fut son être, l'être réel que nous avons aimé, est tout entier à présent disparu. Mais ta mémoire, ami aérien, n'est pas cette chose morte, arrêtée à jamais, immobile derrière la porte d'un tombeau. La pierre que l'on ne soulève pas ne fermera non plus mon adieu. Je serais infidèle à sa lutte héroïque en ne saluant que le néant, et il y eut assez d'amour en lui pour qu'il soit aujourd'hui un peu vainqueur de la mort. Avant de rentrer dans le combat qui fut le sien, j'achèverai cet adieu sur des paroles sereines.
Il a cru sans espérance, oui. C'est ainsi qu'il faut croire ; dans l'œuvre à laquelle il donnait sa vie, nous ne travaillons pas pour un salaire. Il a cru ; j'ai dit dans quel perpétuel et cruel enfantement mais une valeur qu'il n'a jamais mise en doute, c'est la valeur de l'effort humain. Alors que tout se dérobait, ce point d'appui, qui n'est pas formel, qui est l'honneur de l'esprit de l'homme ce dur point d'appui demeurait et ne vacillait pas. Le monde humain, perdu dans l'espace et dans le déroulement des âges, a pu rester pour lui une barbare énigme ; que cette énigme fût insoluble, il le savait, il en était déchiré, il ne s'y résignait pas. Et il croyait en la grandeur d'être irrésigné, et il croyait en la bienfaisante grandeur, en la vertu divine des îlots que sont ces irrésignés épars dans l'océan sans rives. Cette croyance n'est pas une foi pour les lâches, mais, quand même elle a le néant pour mot suprême elle est une foi, elle est le contraire de l'abdication.
A vingt-deux ans, il laisse une oeuvre de force. Elle sera publiée. En elle-même, et parce qu'elle n'est que l'expression de l'oeuvre profonde que fut son âme elle sera pour nous tous et pour l'homme de demain, un témoignage et un exemple. Jeunes hommes de la bourgeoisie qui hésitez au carrefour, l'image de celui qui était né parmi vous peut aider à votre choix ; bien peu oseront prendre sa route, mais nous aurons confiance en ceux qui le suivront, qui n'auront pas peur de la vérité qu'il a dite ; et en cette vérité il y a aussi de la joie. Jeunes hommes du peuple, comme eux vous avez à apprendre de celui qui aima la vérité et la justice bien plus que sa vie ; il était sans vanité et sans ambition, mais il voulait servir. Il a servi, et il est mort « vivant », ainsi qu'il l'avait souhaité.
« Comme moi, espère dans le grand repos. » J'ai dit qu'il avait aspiré à la mort. Plus je me penche vers lui, plus s'impose à moi l'étrange sensation de reparcourir l'expérience d'une longue vie. La mort, le sommeil après la tâche faite, nous devons y songer aussi, nous devons l'aimer aussi ; cela aussi est une pensée bienfaisante aux forts. Lui, il avait tellement rempli sa vie dans ces cinq années de la guerre, que, peut-être, en effet, elle était une longue vie. Voici maintenant devant nous, tout près, le temps des revanches humaines qu'il appelait. Ami, nous te saluons sur le seuil ; ta pensée tout entière est vivante en nous. Comme toi, pour les luttes de la vie nous croyons en l'homme, nous ne croyons qu'en lui; et nous n'épargnerons pas notre effort ; car, comme toi aussi, ami, ami bien-aimé entré avant nous dans le grand repos, comme toi aussi nous espérons.
Marcel MARTINET.
« S'il n'y avait pas une fatalité d'idéal dans les âmes, comment n'abdiqueraient-elles pas devant la fatalité de la nature ? »
Jean DE SAINT-PRIX.
Dans la perspective du souvenir, il vit par le rayonnement de son intelligence. Il l'avait réalisée tout entière, dès son enfance, comme ces ciels tropicaux qui, sans connaître les crépuscules, possèdent d'un seul coup tout le soleil. Ainsi, il s'est éteint brusquement, sans laisser derrière lui ces longues lueurs de nos climats, mais ceux qui l'ont connu à son zénith ne pourront pas l'oublier.
Il vivait dans un flamboiement. L'intelligence en lui n'était pas cette desséchante aptitude à l'abstraction qui est une forme du nihilisme mental ; elle ne s'abaissait pas non plus au pragmatisme quotidien, aux adaptations à la matière qui ne sont que les ruses de l'instinct. Mais, ayant compris toute la vie, il en avait assumé, sans réticence, toute la charge et, tout entier, il s'était voué à elle. Ainsi, il réalisait cette « fatalité d'idéal », grâce à laquelle il n'a pas abdiqué devant les « fatalités de la nature ».
Il savait qu'à lutter contre ces fatalités, l'homme acquiert la dignité d'homme ; il savait que l'asservissement de la matière est la première étape de la libération de l'esprit et qu'à l'accomplissement de cette étape, la société capitaliste, la société militariste, la société théocratique oppose devant la marche des hommes l'encombrement brutal et meurtrier de ses richesses, de ses patries et de ses dieux. Il savait que l'homme peut s'affranchir de ces barrières, et ce n'est point sentimentalement, par simple pitié, mais, consciemment, avec toute la lucidité de son intelligence et la logique honnête que lui imposait sa lucidité que Jean de Saint-Prix était révolutionnaire.
Il savait, lui qu'auraient pu tenter toutes les joies de la contemplation, les fleurs et les musiques de l'art, que ces jouissances supérieures de l'humanité ne sont possibles désormais qu'au prix de la plus douloureuse délivrance et que nos générations volontaires doivent être le ferment dont s'éclora le monde nouveau. Et c'est pourquoi, sans mentir à sa destinée par aucune complaisance, il s'est jeté dans la lutte, devançant ses aînés, manifestant pour nous, qu'arrêtait l'hésitation ou la lassitude, notre conscience même et le hautain devoir, dont sa mort nous a fait le legs impérieux et l'inconsolable abandon.
Joseph Bluter.
JEAN DE SAINT-PRIX
Dans la solitude de sa conscience et de son coeur, sa pensée avait mûri lentement et quand il vint vers nous, avec l'ardeur de ses vingt ans, il était déjà des nôtres, depuis longtemps. Mais tandis que la guerre, chez d'autres, détruisit toute foi en l'avenir humain, lui, sut résister à la funeste contagion de la bêtise et de la férocité. Il garda intactes ses idées reniées, bafouées, par tant d'intellectuels et de militants qui, du jour au lendemain, s'étaient transformés en foudres de guerre. Il assista, l'âme déchirée, au spectacle lamentable des reniements et des trahisons.
Au cours d'un voyage en Suisse, il vit Romain Rolland et ses amis, petit groupe d'écrivains demeurés fidèles à la cause sacrée de l'humanité, pacifistes, déterminés et internationalistes convaincus: Il trouva près d'eux un précieux réconfort. Désormais, il se sentit moins seul.
Je le revois, se présentant à nous, les yeux clairs, l'air doux et pensif, la main cordialement tendue. Dès l'abord, on comprenait qu'on avait devant soi un être d'une intelligence exceptionnelle, d'une sensibilité rare. Il n'était pas nécessaire d'échanger beaucoup de paroles pour confirmer le profond accord de nos sentiments et de nos pensées.
En ces jours sombres, la guerre stupide, démesurément meurtrière, opprimait les consciences probes. Les masses populaires, abusées par une presse servile et vénale, prenaient parti pour le nationalisme et l'impérialisme des gouvernants. Les esprits indépendants étaient condamnés au silence ignominieux. La civilisation s'effondrait sans qu'on pût lui porter secours. L'Europe se suicidait. Un prompt rétablissement de la paix seul la pouvait encore sauver. Mais comment mettre fin à l'assassinat monstrueux et systématique? Ces préoccupations nous obsédaient douloureusement.
Quelles heures d'angoisse nous vécûmes ? Et quelles colères grondèrent en nous! Les fous et les criminels triomphaient en tous pays. Au printemps 1918, nous disposâmes enfin d'une tribune libre, la Plèbe, et nous pûmes exposer, à. coeur ouvert et sans crainte, nos opinions antiguerrières. Jean de Saint-Prix fut un collaborateur talentueux et combatif. Mais, la censure mutila ou supprima la majeure partie de ses articles. Et bientôt, d'ailleurs, MM. Mandel et Clemenceau, adversaires de toute contradiction, supprimèrent le journal qu'ils trouvaient trop vivant. Etre vivant, c'est un crime que ne pardonnent pas ceux qui, pour des conquêtes de territoires, pour de nouveaux marchés ou la vaine gloire du triomphe militaire, n'hésitent pas à mettre le monde à feu et à sang et à peupler les tombeaux.
Jean de Saint-Prix était un vivant dans toute la force du terme. Nul plus que lui n'aimait la vie et ce qui lui donne son véritable prix : la liberté. Tout ce qui comprime, entrave et détruit la vie lui apparaissait comme un blasphème.
Il abhorrait la guerre et l'ordre social qui l'engendre. Des effets, il remontait lucidement aux causes. La solution qui s'imposait, impérieuse, à son esprit : la révolution, il l'appelait de tous ses voeux.
Il admirait la puissance du mouvement révolutionnaire russe et tenait en haute estime ses créateurs : Lénine, Trotsky, Lunatscharsky, Gorky, et le grand peuple idéaliste qui chassa ses tyrans et réalisa la justice sociale.
Par contre, il souffrait vivement de la dépendance des peuples en proie au vertige guerrier, trompés par leurs bergers, et l'isolement moral de la classe paysanne l'inquiétait comme une menace pour toute la famille humaine.
Il était frémissant de révolte devant toute injustice. Il avait le culte de l'amitié. Il plaçait la vérité au-dessus de tout. Il était toute flamme, toute pureté, toute grandeur.
Nous l'aimions comme un frère, et comme un compagnon de lutte parfait. Nous étions sûrs de son coeur solidaire et fraternel. Il savait de son côté, combien nous lui étions attachés. Personnellement, je garderai l'impérissable souvenir de la spontanéité du geste de défense qu'il accomplit en ma faveur à l'heure où, frappé par un gouvernement de forbans, je ne pouvais — étant dans les fers — riposter aux insultes d'une presse policière.
Cet enfant avait en lui tous les courages, toutes les audaces, tous les dévouements. Grand travailleur, il assumait vaillamment des tâches de longue, haleine.
... Avec quelle joie, je le revis, quelques mois plus tard, dans le Bourbonnais, chez Marcel Martinet, autre pur parmi les purs ! Promenades, causeries, brèves heures inoubliables !
Et la mort, sournoisement, foudroya cette noble intelligence. Ce fut l'unique chagrin que nous causa Jean de Saint-Prix, mais ce chagrin durera autant que nous. Notre petit groupe d'esprits fiers et libres a perdu le meilleur des siens.
Nous savons que la perte d'un tel homme est une calamité pour l'humanité entière. Sa vie était consacrée à la défense des opprimés. Il laisse, aux jeunes hommes, un exemple incomparable. Son jeune frère, qui partage sa foi, a, lui aussi, une âme vaillante éprise de vérité et de justice. Il sera fidèle à la grande mémoire de son aîné. Il appartient à la jeunesse frémissante qui sauvera le monde. Qu'il soit assuré ici de notre profonde affection.
Fernand DESPRÈS.
Paris fleuri de Rouge
Peuple de Paris fleuri de rouge ! Peuple de Paris, tu as retrouvé ton sang. Ce n'était pas seulement une protestation contre le crime et l'injustice des juges couvrant le crime. Qui donc pensait à Villain, qui se souvenait des douze haineux imbéciles qui, n'osant le féliciter, épanouirent pourtant sur lui, pour le couvrir, l'ordure de leur âme bourgeoise.
Plus haut fut ton verdict, peuple de Paris ! Dans cette rouge journée d'avril, dans cette journée de mort et de résurrection, je pensais au symbole éternel. Tant de sang répandu, depuis le sang de Jaurès, premier martyr, victime individuelle d'une brute déléguée par les nourrisseurs de Moloch, victime nécessaire pour que fût possible le sacrifice, jusqu'au sang des millions d'humains, versé pour l'unique tentative de cimenter les blocs d'une Bastille sociale effritée et pourrie, écrasée sous le poids des coffres-forts ; tout ce sang fleurissait dimanche aux battements graves et lourds des rouges drapeaux déployés, au rythme des coeurs populaires ; il fleurissait aux paroles des hymnes et dans les yeux et sur les joues des enfants et des femmes, comme il fleurissait les corsages et les boutonnières — et jusqu'à celles — ô ironie ! — des mouchards blêmes et honteux, embellis, pour un jour, d'en être éclaboussés.
Symbole de l'éternel retour ! Fête de la mort au printemps, où dans l'amour des morts, la vie puise la force de renaître (1). Nous avons célébré nos morts, tous nos morts, dont les assassins en liberté peuplent les villes, depuis les caveaux où se tripotent de misérables convoitises, jusqu'aux palais dorés des potentats, en passant par les lupanars académiques, les états-majors et les salons, les banques, les parlements, les secrétariats de comités, de syndicats et de partis et les officines malpropres où les mains corrompues se nouent autour du sac aux trente deniers.
Haceldama ! Champ de sang ! Champ inculte et sinistre, acquis au prix du sang d'un juste et de millions d'innocents, champ immense et dévasté de l'Europe ! Voici que de l'Orient à l'Occident tes nouveaux maîtres épouvantés voient lever de ton sol obscur une étonnante moisson rutilante. Il semble que la terre outragée dégorge le sang qu'elle a reçu, le sang de ses enfants inutilement massacrés, force à jamais perdue dont elle refuse l'hommage. Et la vague déferle sur les collines, comble les ravins, franchit les frontières, fraternité des hommes cruellement retrouvée dans l'égalité de la mort.
(1) C'est le thème de l'admirable Chant de Midi, de Georges CHENNEVIÈRES et Albert DOYEN.
Hommes qui durant quatre ans vous êtes massacrés sans vous connaître ! Frères ! votre sang ennemi s'est confondu au sein de la mère et le voici qui sourd et nous soulève, et c'est lui qui porte la vie, en ce printemps, à nos drapeaux, à, nos chansons, aux joies et aux regards de nos enfants.
Europe ! Europe ! Femelle écartelée, livrée aux bêtes ! Les plus forts de tes fils et les plus innocents sont morts pour que la Révolution soit impossible. Et nous restons, les blessés, les débiles, les désabusés de trop d'espoirs, les forçats déjà fatigués de la pensée, nous restons, attentifs et fidèles, et c'est ton sang, Jaurès, c'est votre sang, ô morts, qui nous ranime et qui revit en nous, pour que la Révolution soit faite !
Alors s'apaisera ce battement fiévreux du cœur, universel, cette souffrance lancinante, cette objurgation impérieuse qui est votre ordre, votre parole : l'ordre nouveau de la justice, la parole qui doit animer l'humanité. Et le sang apaisé, avec nos vies offertes, retournant à la terre, unie en ses provinces comme en la continuité des saisons — mais brandi sur nos têtes, éternel souvenir des martyrs, commémoré dans le drapeau rouge — fleurira désormais les fêtes du printemps et les visages de nos fils — coquelicots parmi les blés — d'une couleur de joie et de triomphante confiance.
Joseph BILLIET.
Les bienfaits du patron, même le meilleur, ne réussissent pas à satisfaire l'ouvrier ; d'abord parce qu'ils lui sont dévolus à titre de munificence, de charité et non de justice ; ensuite parce qu'il peut en perdre le bénéfice en même temps que ses moyens journaliers de subsistance par le fait d'un renvoi arbitraire auquel il est à tout instant exposé.
Mgr BAUDRILLART.
(Discours à l'Académie Française.)
.* *
Il a travaillé trente ans, il a commencé quand la fabrique n'occupait que deux corps de bâtiment, et, aujourd'hui, elle en a sept ! Les fabriques se développent et les gens meurent en travaillant pour elles...
(La Mère.) Maxime GORKI.
L'abondance des matières nous oblige, malgré les quatre pages supplémentaires dont est augmenté ce numéro, à renvoyer au prochain numéro plusieurs articles, parmi lesquels une assez longue étude de LUIGI FABBRI sur le Problème de l'Etat et la Guerre, La Classe paysanne, d'A. CROIX, L'Outil de l Internationale, de HUBERTO FÉREZ, etc.
MOUVEMENT INTERNATIONAL
FRANCE
Deux faits importants, ce mois-ci : le Congrès national socialiste, et la manifestation du 1er mai,
L'impression qui se dégage du Congrès socialiste est une impression d'hésitation, d'irrésolution, de désorientation,- peut-être aussi, et surtout, de timidité.
Tout d'abord, on avait cru nécessaire d'élaborer deux programmes : un programme électoral et un programme d'action générale, le premier, sorte d'édulcoration du second.
Méthode assez déconcertante et qui semble signifier que, dans l'esprit de ceux qui y avaient recours, il y a, deux manières de concevoir l'action socialiste : l'une, lénifiée, expurgée, et bénigne, bénigne, bénigne, à l'usage des électeurs — à qui, en l'occurrence, elle serait alors offerte comme une sorte d'attrape-nigaud ; l'autre, plus accentuée, plus énergique, mais qui serait reléguée à l'arrière-plan des conceptions purement théoriques.
Ce manque de franchise dans l'allure qui admet, somme toute, deux vérités, l'une mitigée, l'autre entière mais d'un usage occasionnel et intermittent, fut une cause de division au sein du Congrès, et un gros obstacle. à une conclusion ferme, claire, significative de cohésion et de volonté résolue.
La question de la troisième Internationale, elle aussi, eut une solution hybride, ni chair ni poisson. On ne repoussa pas l'idée d'adhérer à la troisième Internationale, mais après avoir tenté de tirer de la deuxième le bien que, hélas ! on en a attendu en vain pendant la guerre. L'expérience n'est pas concluante, paraît-il. Et les dirigeants de la deuxieme Internationale chez qui, au moment de la crise, depuis si longtemps prévue par tous les socialistes et les révolutionnaires, du heurt sanglant des appétits capitalistes, l'empreinte nationaliste prima la foi internationaliste précédemment professée, peuvent encore faire illusion et donner à certains un espoir quelconque en une conduite plus éclairée, plus conforme aux principes tant de fois affirmés !
La majorité du Congrès a décidé de continuer à traîner ce poids mort qui paralyse. son action. Et cela au moment où la Révolution gronde partout, où ses premières secousses se .répercutent jusque chez nous ! Quand, plus que jamais, il importe de faire montre d'esprit de décision et d'organisation !
Le 1er mai 1919 marquera dans l'histoire comme une des premières et des plus éclatantes démonstrations de force set de solidarité du Prolétariat. Le chômage — soit total, soit. momentané — qui avait été décidé, fut intégralement observé. Le prolétariat a pu se convaincre que, quand il le voudra, il tiendra la bourgeoisie à son entière merci.
Il lui reste, maintenant, à acquérir la confiance en soi pour sa substitution à la bourgeoisie, dans l'organisation et l'administration de la production des échanges, et de la répartition.
Que partout les groupes producteurs s'enquièrent des conditions économiques de leurs régions respectives, des disponibilités en matières premières, en matériel, en outillage, en moyens de transports, enfin de tout ce qu'il importe de connaître pour organiser la vie sociale d'un pays, et ils seront prêts à prendre en main l'administration économique de la société et à. la faire fonctionner au profit de tous.
Telle est l'ouvre urgente qui s'impose dès maintenant aux syndicats, et surtout aux Comités intersyndicaux, dont il importe de multiplier le nombre au maximum ; parce que, groupant localement des métiers, des industries diverses, ils sont plus aptes que d'autres groupements unicorporatifs à élaborer une organisation d'ensemble, coordonnée dans ses détails.
L'après-midi du 1er mai a été transformée, par le gouvernement du sinistre vieillard, jaloux des lauriers de Thiers, en une admirable tuerie.
Clemenceau est content, bien content ; il fait la guerre...
Jules Vallès qui le connaissait bien, pour l'avoir intimement fréquenté jadis au Quartier-Latin, disait de lui :
"Clemenceau finira dans le sang du peuple."
Dans le sang des peuples est plus exact.
CONDITIONS D'ABONNEMENT
France, 6 numéros_ ……….. Fr. 2,50
- 12 numéros ... .... ..... 4 »
- 24 numéros ……….. 7 »
Etranger, 12 numéros ………… 7 »
- 24 numéros …………. 12 »
Adresser mandats, mandats-cartes ou timbres-poste au camarade HASFELD, à L'Avenir International, 96, quai Jemmapes, Paris.
Le Gérant : André GIRARD.
Imprimerie LA PRODUCTRICE (Ass. Ouv.), 51. rue St-Sauveur. Paris.
Téléphone : Gutenberg 21-78. — E. LANDRIN, admin.-délégué.
Contre les Ames libres de France (Ecrit sans doute à la fin de 1917 ou au début de 1918).
Des voix libres se sont élevées, claires et puissantes, au cœur même des nations soumises à la loi du sang et à la Raison d'État : Liebknecht en Allemagne, Adler en Autriche, Morel en Angleterre, Lénine en Russie. En France, personne. Romain Rolland est en Suisse, et peut-être sa place est-elle bien dans ce pays, où viennent déferler tous les courants intellectuels du monde.
Mais parmi ceux qui sont ici, parmi ceux qui ont vécu une à une les heures funèbres de ces trois ans, aucun n'a émis au grand jour une parole de fraternité et de vérité. Pourquoi ? Ils existent, pourtant, ceux qui auraient pu parler, ils sont nombreux, je les connais. Et ils se sont tus.
Ils invoquent la censure, l'interdiction des réunions, toutes sortes de difficultés pratiques qu'ils déclarent insurmontables. Je leur réponds par les exemples cités plus haut. La vie doit être inventive et créatrice. Une pensée comprimée doit se façonner elle-même une autre issue, et son apôtre doit savoir courir tous les risques et affronter taus les sacrifices, pour culbuter tous les obstacles.
Aucun Français, sur le territoire de la France, n'a eu le courage d'entreprendre un apostolat et l'habileté d'y réussir. C'est un fait, personne ne peut le nier. Des bonnes volontés existent, des velléités se sont dessinées. Mais la timidité et même l'échec sont un crime lorsqu'il s'agit de choses aussi graves et aussi urgentes.
Non que j'attache une importance quelconque à la nationalité des hommes libres. Je suis aussi fier d'Adler et de Lénine que s'ils étaient Français. Car, c'est au nom seul de l'humanité que l'on peut éprouver une telle fierté. C'est une raison autre qui me fait dénoncer comme un crime, le fait qu'aucune voix forte et nette ne soit parvenue à triompher de la conspiration du silence.
Serrés dans l'étau de nos frontières hérissées de baïonnettes, confinés dans l'atmosphère raréfiée d'une nation, il existe, ici comme par tout l'Univers, épars au milieu des fous et des barbares, quelques esprits lucides, quelques cœurs pitoyables. Il existe des mères, des soldats, des enfants, des travailleurs qui n'ont pour toute âme que leur conscience d'hommes. Et alors, ceux-là, en les privant .par votre silence du frère autour duquel ils se seraient groupés et qui aurait parlé en leur nom, vous les avez trahis, vous les avez crucifiés.
Représentez-vous l'agonie morale qu'aura vécue pendant ces trois ans, celui qui n'aura pas été emporté par la rafale nationaliste et guerrière, et qui était trop faible et trop humble pour ne pas s'anéantir en lui-même, et voilez-vous la face. Pour atteindre les âmes nobles et douloureuses, on trouve toujours une voie, lorsque l'on cherche avec ferveur. Mais vous étiez des hommes de peu de foi, et vous vous êtes crus quittes quand vous vous êtes groupés, un certain nombre, et que vous avez dit : « Nous ne pouvons rien » Malheureux ! Dans quel abandon vous laissiez les pauvres dispersés qui vous appelaient, et qui, peut-être, étaient plus sincères encore que vous ! Vous ne compreniez donc pas que vous étiez des pharisiens ? Votre orgueilleux et sombre isolement, votre joie pessimiste et pascalienne de n'agir que par des voies souterraines et restreintes, n'ont rien à envier aux reniements de tous les renégats qui mettent en croix l'idéal dont ils étaient les prêtres.
Jésus a dit que les vertus et les vices étaient les mêmes à Jérusalem et à Samarie. Il n'y a donc point de chrétiens en France ? Voltaire a ri de la tragi-comédie, qui met les hommes aux prises pour des malentendus. Vous qui ne savez pas pleurer, vous ne savez donc pas rire non plus ? Romain Rolland, nous a montré par un roman en dix volumes, qu'un Allemand naît, vit et meurt. Monsieur de la Palisse se serait écrié : « Bravo! J'ai compris ! » d'une voix si forte que tout le monde aurait entendu ; il n'y a donc pas un Monsieur de la Palisse parmi vous?
La vérité, c'est que vous avez effectivement fait un effort, mais que vous admettiez de prime abord que les résistances triompheraient de vous. Si votre désespoir et votre foi avaient été vivants et animés par un souffle d'apostolat, vous auriez soulevé des montagnes. Ce que vous deviez dire était si simple, si nu, si transparent ! Qui n'eût pas compris? Et qui eût pu vous empêcher de prononcer la parole d'amour que chantent la poésie des choses et le gazouillement de l'enfant, ou la parole plus mâle qui fait frémir au fond de l'être, le séculaire esprit révolutionnaire? -
Si vous aviez eu la foi, vous auriez parlé et l'on aurait compris. Mais vous n'aviez pas la foi.
Mais alors, d'autres n'auraient-ils pas dû venir d'ailleurs ? (1) En Suisse, en Espagne, on parlait, oui. Mais pendant ce temps, la France restait une prison, patrie sans porte ouverte vers les autres patries, — hélas ! les patries sont des tombeaux! — sans contact avec l'Esprit, avec le Coeur uniques qui tressaillent par l'Univers et l'emportent de l'éternité à l'éternité, sans qu'aucun homme, — et tous, pourtant, sont les dépositaires de cet Esprit et de ce Coeur, — par-delà les barrières matérielles, n'ouvre assez largement en lui l'écluse, pour que la vérité d'Amour et d'Indignation se rue et déferle sur tous.
Et maintenant, vous, les vrais libres et les vrais humains qui vous êtes tus ici ou qui n'êtes pas venus d'ailleurs, pensez à vos victimes. Vous aurez peine à les compter dans le monde des âmes ; et dans le monde des corps, vous verrez
(1) Je ne parle pas de ceux qui ont vraiment un rôle à l'étranger, et qui, comme Rolland ou Guilbeaux, y livrent un combat fécond, mais de ceux qui s'y sont « réfugiés ».
qu'elles sont aussi nombreuses qu'il y a de morts sur tous les champs de bataille, puisque tous ont été tués avec votre consentement implicite. Alors, qu'est donc votre liberté, qu'est votre humanité ? Elles ont tout juste la valeur d'une restriction mentale! Dérision!
Car, lorsque la réalité de la vie et de la mort sont en jeu, la réussite seule prouve la valeur des convictions. Après un naufrage, donne-t-on la médaille de sauvetage au prêtre qui récite des prières pendant que le bateau. coule, ou aux matelots qui mettent les barques à la mer ? Elle est trop commode, la -morale de l'intention ! Est-elle plus efficace, après tout, que le hautain mépris du stoïcien?
Il y a ceci encore en vous. Commençant par admettre que les résistances triompheront de vous, vous finissez par vous en amuser. Plus vous êtes persécutés, plus vous croyez avoir de mérite, et plus vous êtes fiers de vous sentir différents des autres. Alors, pour vous prouver que vous ne pactisez pas et que vous tentez tout, vous vous répétez à satiété : « J'ai eu tant de lignes censurées... J'enverrai cela en Suisse... J'y renonce, ce n'est pas de ma faute... Comptons sur la Révolution Russe, sur les Italiens... » Pourquoi pas sur les Peaux-Rouges? Croyez-vous donc que ceux qui sont ici, tout seuls, et qui voient la réalité présente sans promener leurs rêves aux quatre coins du monde, croyez-vous qu'ils puissent attendre et se contenter de vos raisons ?
Oh! Assez étouffer ! Proudhon disait : « Je suis une voix d'honnête homme qui crie dans le désert! » Il y a des honnêtes gens, ici. Pourquoi n'entend-on pas leur voix ?
Vous vous demandez pourquoi on n'a pas entendu la mienne? Parce que, lorsque la guerre a éclaté, j'étais presque un enfant, parce que j'étais aussi parmi la troupe obscure de ceux qui attendaient un Messie, parce que cela m'a trop désespéré pour que je sois ce Messie.
Vous qui êtes plus forts que moi et qui n'avez rien dit, est-ce que vous n'aurez donc jamais de remords? Insensés, qui n'avez pas agi comme si un Christ était caché au fond de chaque homme, et comme si votre âme, ainsi qu'elle devra le faire à sa dernière heure, portait un jugement définitif sur les actions de votre vie!
Insensés, qui ne savez pas que l'on est bon et vrai à la seule condition de croire en la dignité de l'homme et d'être prêt à mourir avec sérénité ! Jean De SAINT-PRIX.
A NOTRE JEUNE FRÈRE
Maintenant qu'il nous a quittés, nous pouvons dire l'amour que nous avions pour lui.
Il nous était apparu comme un jeune prince de Shakespeare, un poétique adolescent, toutes les forces de la vie et de la mort luttant en un corps frêle : tendresse et ironie, don du rire et des larmes, soif de se dévouer, ardeur de tout comprendre, besoin chevaleresque de courir au secours des opprimés, d'offrir sa poitrine aux coups qui leur étaient destinés, passion brûlante de la vie et désespoir passionné du néant... Cette âme remplissait tous les étages de sa maison, de la base au faîte...
Qu'une fleur aussi pure ait surgi du milieu des tristesses, des bassesses de ce temps, c'était comme un miracle. Et ceux qui en furent témoins, d'abord un moment incrédules, en concevaient ensuite un sentiment d'amour presque religieux. C'était, une chose touchante de voir ces hommes âgés, sceptiques ou révoltés, tannés par la dure, l'amère expérience, qui devant ce cadet s'inclinaient avec un tendre respect, tant est rare la lumière, et puissant son attrait sur les coeurs qu'enveloppent les brouillards méphitiques d'un monde agonisant.
L'étoile a disparu, mais sa lueur persiste dans les yeux qui l'ont vue. Et nous continuons de suivre sa trace au fond de la nuit. Maintenant, il est au but, notre jeune compagnon, il a d'un bond atteint le terme où nous arriverons tous. Et moi, qui ne prie guère, j'éprouve le besoin, parfois, de m'entretenir tout- bas avec notre petit frère, et je lui dis :
« Maintenant, conduis-nous ! Tu es maintenant notre aîné. »
Romain ROLLAND.
souvenir
Jean de Saint-Prix est venu me voir un jour en se présentant lui-même, sans mot d'introduction. Il m'a plu de suite. Plus. Il m'a produit l'impression d'une nature supérieure. Et je l'ai prié de me faire l'honneur de son amitié. Au moment de la révolution bolcheviste, mon attitude critique au sujet de la dissolution de la Constituante et de la terreur le révolta. Il m'a écrit une lettre violente en demandant de la publier dans. La Vérité. Je remis la lettre au directeur de ce journal, en déclarant que je ne m'opposais pas à sa publication. La sincérité de Saint-Prix fut si évidente, sa violence eut des motifs si nobles que nous restions en rapports cordiaux. Et je dois à sa mémoire et à la vérité d'avouer qu'il n'avait pas tout à fait tort en me disant que notre devoir est non de souligner ce qui nous sépare, mais ce qui nous unit, nous et la grande révolution bolcheviste. Et si je me suis conformé depuis un an à cette tactique, je le dois un peu à Saint-Prix. Merci, cher et regretté camarade !
Charles RAPPOPORT.
Jean de Saint-Prix et nos Jeunesses Rouges
Nous regrettons amèrement Jean de Saint-Prix. Il représentait une de nos plus chères espérances. Il eût été un guide précieux pour la jeunesse héroïque dont a besoin l'élaboration des temps nouveaux.
Mais il n'est pas mort tout entier. Il survit dans son œuvre. Et cette œuvre c'est, en outre et au-dessus des pages délicates, fines et ardentes qu'il a écrites, l'exemple même de son activité, tout entière consacrée au plus pur des idéals humains.
Son grand cœur acceptait sans hésitation et sans réticence le devoir de fraternité et de sincérité qui sera le salut de l'humanité si douloureusement éprouvée. Ou plutôt, pour mieux dire, l'âme de Jean de Saint-Prix était ce devoir même. Ce devoir était sa vocation naturelle et sa vie.
Nous ne dirons pas qu'il « allait au peuple ». C'est une expression orgueilleuse, fausse, et d'ailleurs depuis longtemps périmée.
Il allait droit à la vérité intellectuelle et sociale, droit à la beauté littéraire, esthétique et morale.
Sa fine nature sentait à merveille combien la vérité sociale est élégante et belle. Et son sens critique, très averti, très sagace, n'avait pas de peine à le convaincre que la prétendue élégance qui repose sur le mensonge social et sur l'institution d'une classe privilégiée et exploiteuse, est factice, menteuse et vile.
Il vivait dans la parfaite et calme lumière de la raison et de l'art.
Mais par respect et par amour pour cette lumière, il combattait tout ce qui est ténèbres et mensonge. Il militait non par haine, mais par scrupule de sincérité, par passion de la vérité. Il militait par délicatesse. Sa sincérité, sa logique, sa générosité, son désintéressement l'avaient porté à l'extrême gauche de nos « Jeunesses Rouges », dans le groupe des étudiants socialistes et internationalistes révolutionnaires.
C'était parfait. L'héritier intellectuel des La Boétie et des Vauvenargues ne pouvait être à sa place que là, et nulle part ailleurs.
Et c'est là, sur ce champ de bataille volontairement choisi par lui, qu'il contracta la maladie dont il est mort. Sa frêle santé, qui l'avait fait si légitimement réformer, ne put pas résister à la fatigue d'une de ces réunions « privées » que nos Jeunesses Rouges sont obligées de tenir dans des locaux misérables et insalubres, à cause de la modicité de leurs ressources, à cause, surtout, des persécutions policières et gouvernementales.
Ainsi Jean de Saint-Prix est mort, pour ainsi dire, en pleine action. Il est mort de cette action, mort de son dévouement.
Il est mort surtout de son grand coeur. La pensée de la guerre le torturait. Cette discrète, mais âpre et profonde douleur le minait sourdement. Cette préoccupation était, pour son exquise sensibilité, pour la finesse et l'élégance de sa raison, pour la délicatesse de son organisme, un supplice de tous les instants.
Et, d'autre part, il n'avait point encore cette maturité d'âge et de talent qui permet aux Romain Rolland et aux Barbusse de se consoler en écrivant des livres accusateurs et vengeurs, et en créant d'impérissables chefs-d'oeuvre.
En toute vérité, l'on peut dire que Jean de Saint-Prix est mort de la guerre, mort de la mort des autres.
Les jeunes gens qui lui survivent, les jeunes socialistes internationalistes révolutionnaires le vengeront en jetant à bas l'édifice économique et social d'exploitation, de mensonge et de haine pour qui l'âme exquise de Jean de Saint-Prix éprouvait un si parfait mépris.
Jean de Saint-Prix vivra dans leur mémoire.
Dans les heures d'amertume, dans les jours d'épreuves qui très .certainement les attendent, son souvenir brillera comme une lumière dans la nuit. La douceur de son âme, toujours présente en eux, adoucira les inévitables souffrances.
Et en méditant sur la rectitude absolue de sa pensée et de sa vie, ils prendront en haine et en dégoût ces demi-vérités par où échouent les révolutions, et par où périssent les meilleurs et les plus purs de «ces hommes vraiment fraternels qui se dressent comme les statues magnifiques du droit et de devoir». C'est Barbusse qui, dans Clarté, les définit ainsi.
Jean de Saint-Prix eût été un de ces hommes-là.
Il est mort en vue de la terre promise. Mais la jeune génération qui surgit, et qui s'est révélée récemment le jour de la manifestation en l'honneur de Jaurès, conservera à sa mémoire, le pieux et tendre respect qu'on doit aux précurseurs prématurément ravis.
Emile CHAUVELON.
—————————
SOUVENIRS
Mon cher Fernand Desprès m'avait dit, dans des lettres pleines d'émotion, quel frère de pensée, quel ami affectueux il avait rencontré en Jean de Saint-Prix. Il m'avait raconté avec quelle ardeur et quelle flamme ce jeune homme, qu'une situation sociale privilégiée invitait à une carrière bourgeoise, égoïste et féroce, avait épousé la cause de l'humanité contre la sauvagerie et voulait servir l'intelligence et l'amour contre l'imbécillité et la haine.
Quand, il y a un an, des persécutions odieuses atteignirent Desprès, que, sans motif, il fut jeté en prison, traqué, diffamé par des mouchards et que des plumitifs serviles s'efforcèrent d'échafauder contre lui une accusation que les policiers n'avaient pu arriver à mettre sur pied, Jean de Saint-Prix fut un des rares hommes qui prirent publiquement la défense de notre ami. Il le fit courageusement, à défaut de tant d'autres, dont le silence fut une lâcheté, plus qualifiés parce qu'ils connaissaient Desprès depuis plus longtemps et savaient mieux que personne sa vie simple, non seulement insoupçonnable mais exemplaire, dans l'isolement d'une conscience scrupuleuse et hautaine. Mais qu'importe le sort d'un honnête homme restant volontairement solitaire et pauvre pour demeurer propre, à des gens, à la foule des gens, que la soif de notoriété et de pécune écarte peu à peu de tous scrupules ? Il faut être promu à l'admiration des badauds, être un cabotin ou un rastaquouère, un « as » de la politique, de l'art, des sports ou de la guerre, ou encore un distributeur de sportule, pour intéresser ces ambitieux. Pour ces « surhommes à la manque », qui, indifféremment, pourront devenir ministres ou aller au bagne, un honnête homme est un être inférieur.
Jean de Saint-Prix défendit Desprès avec tout l'élan de sa jeunesse et surtout avec la confiance absolue qu'il ne pouvait se tromper quoi qu'en pussent dire les augures policiers. Il est des rayonnements et des certitudes dont les consciences fausses ne peuvent donner l'illusion ; il est des élans que seules peuvent avoir les âmes pures et qu'aucune hypocrisie ne peut simuler : Desprès et Saint-Prix étaient deux belles âmes qui devaient se comprendre, s'aimer, et qui ne pouvaient se tromper mutuellement.
... Nous ne nous sommes vus qu'une seule fois. C'était en août dernier, à Montélimar. Saint-Prix était venu m'attendre à l'arrivée du train. Notre poignée de mains et notre conversation furent immédiatement celles de deux amis. Par-delà les distances, nous étions unis depuis longtemps par une révolte, une douleur, des rêves et des espoirs communs.
La journée était chaude. Dans le jardin public où nous nous promenions des odeurs de buis embaumaient la lourdeur de l'air. Les seuls bruits venaient de la gare toute proche. De malheureux oiseaux exotiques, dont une grue couronnée qui ressemblait à une femme à la mode marchant sur des talons trop hauts, s'ennuyaient dans des cages. Quelques personnes somnolaient sur des bancs, ne s'ennuyant pas moins, et ces gens, comme le jardin, comme les oiseaux, comme toute la ville, semblaient loin de la vie, loin de toute humanité.
Jean de Saint-Prix gémissait sur les existences pétrifiées des sous-préfectures, sur leur absence de pensée personnelle, leur entêtement solide dans des préjugés dont la masse effrayante semble braver le temps et devoir éterniser la misère du monde. Le mensonge de ces préjugés n'avait-il pas réussi à déclancher le plus épouvantable des crimes ? Contre ces forces mauvaises plongeant leurs racines dans vingt siècles de sottise routinière, qu'avaient pu faire les espoirs de vie nouvelle péniblement édifiés ?
Les grands principes étaient-ils autre chose que des formules «destinées à bercer l'impatience des hommes voulant aller de l'avant ? Liberté, justice, amour, sont depuis toujours des aspirations auxquelles le mensonge donne journellement un travestissement nouveau pour les faire servir à ses fins : caché derrière elles, il abuse les pauvres hommes qui, trop souvent, ne demandent qu'à être abusés. Devant la catastrophe, tous les grands principes avaient été emportés et, avec eux, les groupes humains qui devaient être leur appui : organisations politiques, économiques, religieuses, artistiques, avaient perdu toute signification universelle et humaine pour devenir nationalistes. Le cercle étroit des patries s'était fermé sur l'universalité des âmes, et le citoyen avait tué l'homme.
Ceux qui voulaient demeurer des hommes étaient restés seuls, suspects et menacés ; la solidarité humaine sombrant n'avait plus de refuge que dans les consciences choisissant des solutions individuelles. Que devaient faire ceux qui ne voulaient pas participer au crime ? Chacun devait agir personnellement, selon les circonstances, suivant ses possibilités particulières. Jean de Saint-Prix aurait refusé de porter un fusil ; il serait allé, dans ce refus, jusqu'au sacrifice de sa vie. Il n'aurait pas été guidé en cela par l'obéissance d'un Tolstoï à la loi chrétienne : il aurait accompli simplement son devoir humain, suivant le libre choix de sa raison et de sa conscience. Dans un parfait équilibre de ses facultés, il jugeait que les opinions doivent se résoudre en actes : internationaliste, il n'aurait pas fait la guerre des patries ; révolutionnaire, il aurait fait la révolution.
Il avait appris qu'un prêtre avait prêché contre R. Rolland et contre les pacifistes. Il était allé le voir pour protester et pour lui demander comment il pouvait concilier le nationalisme et le bellicisme qu'il manifestait avec l'enseignement du Christ. Et le prêtre, à bout d'arguments, avait fini par répondre qu'il était plus patriote que chrétien !
Que pouvait-on espérer ? L'humanité se dévorerait-elle ainsi toujours ? La dignité d'abord, l'amour ensuite, ne régénéreraient-ils jamais les consciences, et les progrès sociaux ne seraient-ils toujours que de nouveaux blanchiments d'un sépulcre? L'homme n'irait-il pas, enfin, vers l'avenir en se donnant librement à la vie, et en abandonnant derrière lui tous les cortèges de mort du passé?
Une grande lumière s'était levée du côté de l'Orient et éclairait les jeunes espoirs. Tolstoï avait dit aux peuples comme aux individus : « Le Salut est en vous! », et des peuples paraissaient l'avoir compris et vouloir briser les chaînes de leur servilité. Pouvait-on espérer la propagation de l'incendie libérateur? Pouvait-on être optimiste? Oui, on devait l'être de toute son âme, de toutes ses forces.
Malgré tout, la vie est plus forte que la mort. L'humanité vit dans le mensonge et le crime, mais elle vit, et elle porte en elle des forces de rédemption. En elle rayonnent toujours des hommes qui sont l'Esprit, c'est-à-dire la Justice et la Vérité. Ils ne sont pas nombreux, mais ils ont une puissance invincible, celle de l'Idée qui ne meurt pas et qui fondera peut-être une humanité abondante en sagesse.
C'est une loi naturelle observée par Elisée Reclus que, malgré toutes les calamités, il y a une masse de bien supérieure à celle du mal : l'effort humain ira peut-être un jour vers ce bien.
Et même, si l'humanité devait tourner à jamais dans un cercle d'infamie, nous devrions encore rester optimistes pour nous-mêmes, pour la possibilité d'une vie que nous ne voulons pas chargée de dégoûts, pour notre gloire intime, pour notre fierté. Même las, accablés, notre optimisme ne doit-il pas s'alimenter de cette expérience, qu'il est plus facile et moins fatigant de faire de bonnes actions que des mauvaises, d'être un brave homme que d'être une fripouille, sans compter la sérénité qu'on en retire et qui a un prix incomparable pour qui a tant soit peu le respect de soi-même.
... La nuit était venue. Dans le calme plus pur du soir, nous évoquions, de Socrate à Tolstoï, de Rabelais à Shakespeare, à Beethoven, ceux qui, dans la beauté et dans l'amour, ont fondé les raisons éternelles de l'optimisme humain. Une grande douceur et une foi ardente nous pénétraient. Nous sentions qu'une infinie miséricorde pourrait descendre parmi les hommes et les faire meilleurs, par l'effort de tous ceux de bonne volonté.
Voilà les souvenirs d'une rencontre avec Jean de Saint-Prix. Une soirée récente m'a rappelé encore, bien à propos, son indignation du refus opposé par les professionnels de la musique, boutiquiers d'art, à l'exécution à Paris de la Neuvième Symphonie de Beethoven (1). Un grand pianiste lui avait dit que ce serait de l'indécence !...
Or, j'ai assisté à une soirée fort émouvante, réplique de
(1) Ces espèces sont de partout. Je les ai vus, ces professionnels, à Marseille, descendant le buste de Beethoven qui honorait la salle des concerts et refusant de jouer la musique de ce « boche », mais jouant sans remords celle du surboche Meyerbeer dans d'incessantes représentations des Huguenots, de Robert le Diable, de L'Africaine, etc...
l'intelligence triomphante à la pudibonde imbécillité des marchands d'art, et qui aurait enthousiasmé Saint-Prix.
Par l'initiative d'Albert Doyen, au milieu d'une foule populaire accourue pour communier dans la Beauté, des chœurs, composés de travailleurs réunis pour leur propre joie, chantèrent le final de cette Neuvième Symphonie ; et c'était le plus beau cri d'espoir qu'on pouvait entendre.
Il me confirmait ce que nous nous étions dit avec Saint-Prix : la folie des hommes n'est que le résultat du système d'abrutissement auquel les soumettent ceux qui les dirigent. Ce n'est que par une préparation habile qu'on les a conduits à la guerre. Comment pourrait-on dire : « N'oubliez pas! La haine est sainte! » et autres inepties à des foules qui seraient familières dans la compréhension d'un Beethoven? Ce serait impossible, et c'est pourquoi on distribue aux foules la bêtise des cinémas, des music-halls et autres lieux de dépravation intellectuelle et morale, comme on gave d'alcool les malheureux qu'on envoie à l'assaut.
Que le peuple arrive à se débarrasser de tous ses abrutisseurs, de tous les misérables qui n'ont d'efforts que pour l'avilir et le maintenir dan la sujétion ; puisse aller librement vers la Beauté, et il saura alors réaliser sur les ruines du vieux monde abattu, l'œuvre de liberté et de fraternité dont Beethoven a été l'annonciateur mélodieux.
Edouard ROTHEN.
L'Internationalisme de Jean de Saint-Prix
Les esprits véritablement internationaux sont rares.
La grande Révolution bourgeoise, et l'Empire qui lui a succédé, ont formé la société européenne moderne en la pétrissant pour ainsi dire d'une notion exhumée de l'antiquité païenne : la lâtrie patriotique. Cette société, qui fut la nôtre. hélas ! aura duré cent ans environ. Elle est finie, et l'on sait dans quelle sanglante frénésie ! La société nouvelle ne pourra reposer que sur la base internationale.
L'idée de Société des nations est à peine un indice velléitaire d'avenir, un consortium d'intérêts par un compromis temporaire. Le mot nation subsiste ; autant dire Addition de divisions. Ce sont les divisions qu'il faut abolir et non consacrer à nouveau. « Le genre humain est un par essence, dit Lamennais, et l'ordre parfait n'existera, et les maux qui désolent la terre ne disparaîtront entièrement que lorsque les nations, renversant les funestes barrières qui les séparent, ne formeront plus qu'une grande et unique société. »
Les protagonistes des différents projets de Société des nations sont encore enfermés dans la gangue des patriotismes ; il faudra qu'ils s'en libèrent. Ou, plutôt, il en faudra d'autres, qui soient moins Grecs et Romains, et qui veuillent bien consentir à laisser les hommes penser et vivre par et pour eux-mêmes, au lieu de les faire sentir et mourir par Plutarque.
A l'heure actuelle, il semble encore que le plus gros effort de libération, même de ceux qui se disent affranchis, consiste à adopter la ridicule attitude de l'âne de Buridan ; et l'on a ouï au procès Villain des hommes politiques ni chien ni loup, ni chair ni poisson, qui ont proclamé que le véritable internationalisme menait au nationalisme, et aussi que le meilleur national était l'international. Impuissance, hybridité de la pensée. Il y a des personnalités notoires qui traversent la vie en demeurant à l'âge ingrat, et dont l'idéal est une perpétuelle mue. « Quoi ! dit l'académicien quinquagénaire, on a pu douter de mon zèle patriotique et belliciste ! Qu'à cela ne tienne : je vais de ce pas passer le conseil de révision ! » On vous défend la viande, dit le médecin de Montaigne ; ne vous chaille, je vais vous l'ordonner.
Michelet, Hugo, Jaurès, parmi les plus fameux, ont donné de hauts exemples de cette incertitude morale, et c'est un jeu de choisir dans leurs oeuvres des pensées qui se contredisent radicalement sur le point Humanité, Patrie ! Tout récemment M. Barrès a pu, en citant Victor Hugo, prouver qu'il était chauvin ; et l'on a immédiatement pu le démentir en produisant d'autres de ses textes qui prouvent qu'il fut humain ! Triste jeu, car ces pontifes, ainsi que beaucoup d'autres, en révélant leur propre confusion sur un point aussi fondamental, n'ont pas peu contribué à l'épouvantable et burlesque équivoque en vertu de laquelle les hommes qui veulent la vie et la paix, consentent pourtant, sur le signal de leurs diplomates, à la guerre et à la mort !
Les esprits véritablement internationaux sont encore peu nombreux parce que la force de caractère est plus rare que le talent ou le génie. Bien peu ont le courage de confesser avec Tolstoï : « Tous les hommes sont également mes frères ! » Notre Jean a eu cette force. Il avait déjà brûlé l'étape douteuse de l'inconsistance morale, et il se trouvait, à 22 ans, de plain-pied avec le voyant d'Iasnaïa-Poliana. J'en atteste ma chère soeur en Tolstoï, Véra Starkoff, qui a bien connu cet aspect de sa grande âme. Il est venu avec tout son coeur généreux, sa raison limpide et sa profonde culture à l'Internationalisme intégral. On ne peut à la fois diviser et réunir. « Qui n'assemble pas disperse », a dit le grand international Jésus. Il faut choisir. Saint-Prix avait choisi. Qu'il me soit permis, à moi, le doyen de ses intimes, de le proclamer sous le titre de cette publication où il a écrit. Sa mort est une grande perte pour l'avenir humain. Que n'eût-il pas donné ?... Nous cherchons, nous cherchons un caractère de la force de cet enfant !...
Gustave DUPIN.
JEAN DE SAINT-PRIX
(26 Septembre 1896 - 18 Février 1919)
Le 4 août 1914, je n'avais pas tout à fait 18 ans. Tout de suite j'ai été résolument, sans restriction, contre la guerre. Seulement, la chute brusque de mes illusions d'adolescent, ma solitude et la réalité de la guerre, contre laquelle ma révolte ne pouvait rien, m'ont fait souffrir. Alors je me suis tourné vers les choses de l'âme, comme vers un refuge, parce que j'étais trop jeune pour porter cette douleur.
Jean DE SAINT-PRIX.
Oui, il était bien jeune. Bien jeune pour porter la monstrueuse douleur du temps où, plein d'amour et de foi dans les hommes, il s'ouvrit à la vie ; mais en tout temps et en tout âge, sa force eût été inférieure à sa souffrance, parce que cette souffrance, incroyablement désintéressée et riche, était une vocation, et qu'elle rassemblait en lui, avec une puissance passionnée, les plus complexes douleurs du monde.
Vous qui l'avez connu et qui rappelez son corps charmant et frêle, ne laissez pas mourir en vous son image, qui aux plus sombres heures fut l'image de notre jeunesse, et notre clarté dans la nuit. Et vous tous qu'il aima sans vous connaître, avec nous penchez-vous sur son existence et retrouvez en nous la perte que vous avez faite, vous aussi..
On a évoqué l'inclinaison légère de sa tête vers l'épaule, quand il écoutait et qu'il allait répondre ; il est là en effet, dans cette pose familière. Son attention méditative le livre ardemment à la vie extérieure, en un don de soi sans calcul ni réserve, et cependant elle se ferme sur un secret ; ceux qui l'aimaient ont respecté cette pudeur dont il était tout empreint ; ils l'ont trop respectée peut-être, car elle enveloppait les deux pôles entre lesquels il s'est débattu avec une violence qui a contribué à le briser.
Pourtant, qu'il est jeune et clair! En quelque compagnie qu'il fût, nulle fausse timidité d'adolescent, nul embarras ; mais un rien de gaucherie d'enfant, qui donnait à son allure et à toute sa personne une délicatesse féminine et fragile. Le bas de son visage, avec les lèves tendres, le galbe un peu large de ses joues et la rondeur du menton, la fine ondulation de ses cheveux sur les tempes, tout cela et surtout sans doute l'inexprimable pureté qui émanait de lui, le faisaient paraître plus jeune encore qu'il n'était. Mais, comme chez tous les êtres où l'âme est grande, c'étaient ses yeux d'abord qui appelaient, et sa grande âme vierge et frémissante se donnait d'abord dans la lumière de son regard.
Lumière qui ne s'éteindra en aucun de ceux qui l'ont aimé.
Devant elle on ne s'occupait plus de sa jeunesse ; la lumière n'a pas d'âge. Jeunes, certes, ses yeux l'étaient aussi, neufs et caressants comme les yeux de ces tout petits qui l'ont toujours attiré et qu'il a eu l'extraordinaire pouvoir de comprendre ; mais leur profondeur de pensée, leur mystérieuse gravité, leur sérénité, et soudain ces creusements étranges... Non, cette lumière ne s'éteindra pas en nous.
Il parlait. Nos faibles mémoires, que retiennent-elles de la voix de nos morts ? Je me souviens que la sienne était douce et précise, sans chantonnement, d'une sonorité bien posée, avec des inflexions où passaient sa bonté affable et son soin de ne jamais nous peiner. Avec une hésitation parfois, un effort, comme pour s'arracher à lui-même.
La bonté, ce n'est pas la vertu d'un jeune homme de vingt-deux ans. L'aspiration vers la pureté en est une davantage, mais non à ce degré de fièvre qui le dévorait. Quand nous l'avons perdu, beaucoup ont dit, et des hommes faits et de vieux hommes : « Il était le plus pur d'entre nous. » Ce n'était pas une vertu stoïcienne ou chrétienne, qui utilise et sacrifierait l'univers pour croître et s'affiner ; son coeur généreux répugnait aux pharisaïsmes, et d'abord à celui du perfectionnement individuel solitaire. Mais d'un mouvement que rien n'arrêtait, sa nature s'insurgeait contre tout ce qui est corrompu dans l'homme et dans la société, et allait vers tout ce qui est sain, beau et vrai ; par là il a cru à la liberté et à la justice, et il s'est d'instinct trouvé prêt à lutter pour elles.
« Le plus pur. » Nous ajoutions : « Et le meilleur. » S'il chercha cette lutte de même que s'il eut cette compréhension des enfants que je rappelais, c'est qu'il voulait toujours, par nécessité intellectuelle, remonter aux sources de la vie, et c'est qu'il était bon, étonnamment bon.
Il souffrait personnellement de voir souffrir, quelle que fût la souffrance, quel que fût l'être souffrant ; et il voulait souffrir ainsi. Plusieurs fois, il a cité ce mot de Pascal . « Jésus sera en agonie jusqu'à la fin des siècles. Il ne faut pas dormir pendant ce temps-là. » Et ceux-ci de Tolstoï : « Les hommes sont malheureux, ils souffrent, ils meurent ; on n'a pas le temps de flâner et de s'amuser. » Je ne crois pas que quiconque, et pas même Pascal et Tolstoï qui les écrivirent, ait vécu plus intimement que lui l'angoisse tragique de ces phrases. Il n'a pas voulu flâner, s'amuser, dormir. Et lui dont la sensibilité était brûlante, il n'a sans doute haï personne. Son coeur était tout amour.
Je n'écris pas un panégyrique. J'écris un adieu plein de douleur. J'écris à mon ami qui est mort, et pour essayer de dire l'homme que les hommes ont perdu. Cet ami, qui fut le plus véridique des êtres, si je flattais sa mémoire d'un terme qui forçât le moindrement la vérité, ce serait un sacrilège. Alors, si je dis vrai sur lui, on sera surpris non qu'il ait quitté un inonde maudit, mais qu'il ait pu, y vivre vingt-deux ans. Souvent moi aussi j'en suis surpris. S'il a pu y vivre, c'est peut-être justement parce qu'il fut tout amour, et que l'amour le soulevait un peu de terre. Quand il était là, corporellement, comme spirituellement, il nous semblait un peu aérien ; et je pense que lui-même en eut quelque sentiment. Mais maintenant il a disparu, Ariel.
***
Si je dois me briser les ailes, je ne puis le savoir qu'en m'envolant.
Jean DE SAINT-PRIX.
Il croit, il aime ; ses compagnons d'alors se souviennent de son adolescence, de sa pensée déjà puissante, de tant de richesses intérieures qui vont s'épanouir : car voici la jeunesse.
La jeunesse ! « Je n'avais pas tout à fait dix-huit ans... » Et ce fut la guerre.
Il semble que sous ce coup, il y ait eu dans sa vie une rupture affreuse où il douta de tout. Mais cet enfant, au coeur héroïque va faire l'apprentissage des retours éternels entre lesquels il sera écartelé ; son désespoir devant la folie et le crime des hommes lui sera un tremplin pour s'élancer vers une foi plus hardie et plus sereine, et vers l'action.
La conscience de ses aînés fléchit ; parmi les jeunes, les âmes moins bien trempées, les intelligences plus courtes glissent au scepticisme, abdiquent leur destinée, se perdent dans un amour de soi sans issue. Lui, il accepte sa maturité brusquée ; il est sauvé du néant par l'excès même de sa douleur. Et c'est aux jours du crucifiement de l'homme et de la révolution reniée qu'il se donne de toutes ses forces aux grands vaincus.
Cette période, où il s'est le plus dépensé extérieurement, fut sans doute aussi la plus tonifiante de sa vie ; en quelques mois, quand ceux qui avaient juré de veiller dormaient, il aura le temps de remplir une existence militante passionnée, d'ailleurs réfléchie et féconde.
A la plupart de nous, il n'était apparu qu'alors ; et avec la grâce de sa jeunesse et son coeur intrépide, il était comme l'ange de la révolution. Il revenait de Suisse, où il avait rencontré des hommes fidèles. Il en avait rapporté une flamme brûlante ; et il aurait voulu se jeter entre ses frères égarés, et sauver le monde.
Il aurait tout donné, son intelligence, sa santé, sa vie. Il avait tous les courages, et parfois nous tremblions de le voir, lui si pur, dans cette mêlée boueuse où nous sentions qu'il aurait donné jusqu'à son honneur s'il avait jugé que le sacrifice de son honneur était utile. Non qu'il fût inconsidéré ; ce n'était pas une des moindres forces de sa nature, que son enthousiasme fût raisonné, que sous son apparente douceur il eût une sévère volonté de domination de soi, et qu'il calculât avec un sens très ferme ses plus audacieuses initiatives. Mais pour lui, si respectueux de la personne humaine, il n'y avait qu'un être qui, devant la grande misère des hommes ne comptât point, et c'était lui-même.
C'est pourquoi il n'hésitait pas à utiliser son nom dans la lutte, alors qu'il était d'une délicatesse et d'une réserve extrêmes, et qu'il refusait de devoir à son origine aucun avantage personnel. Naturellement beaucoup le comprenaient mal, et même des amis se méprirent devant une modestie et une simplicité qui dépassaient en effet les communes mesures.
Méprise est un terme impropre. La supériorité secrète répandue en lui, on peut croire qu'après une période d'attirance, elle éloignait légèrement ceux qui n'étalent pas dans son intimité immédiate. Cet éloignement faussait leur compréhension ; des hommes qui avaient de la sympathie pour lui ont pu craindre qu'il ne se mît en avant, alors qu'il ne se mettait qu'en premier rang du risque, avec le seul souci d'employer, dans un absolu désintéressement de soi, toutes les armes à sa disposition.
On sait avec quelle bravoure il en usait. Était-il né, lui si fin et si doux, pour cette bataille cruelle? Mais c'est avoir une basse idée de l'action que de la réserver à des lutteurs forains ; là aussi les méditatifs sont les meilleurs, quand la probité et la tendresse du coeur réchauffent en eux la logique de l'esprit. Jean de Saint-Prix entre dans l'action, comme un Aymerillot, sans choisir ses adversaires et sans considération des dangers qu'il courra.
Contre toutes les puissances de haine, d'oppression, d'injugtice, contre les sophismes cérébraux et les lâchetés morales des passifs, contre les tièdes surtout, et jusques contre nous, qui n'avions pas su inventer le salut des hommes... Comme nous l'aimons, de ne s'être pas satisfait de notre pauvre effort!
Ainsi il se multiplie. « Il voulait », écrit quelqu'un qui l'a entièrement connu « accomplir sa destinée et son oeuvre sans se laisser arrêter par rien ni personne. » Et il veut aussi, c'est sa destinée et son oeuvre, donner toutes ses forces, en tous sens, à ce qui lui paraît alors la tâche unique. Nous redoutons parfois cette dispersion. Mais il va ; et nous finissons par comprendre sa calme obstination, nous respectons complètement sa liberté : lui-même il se créera sa discipline, il se regroupera selon sa loi propre... Hélas !
Contre les tièdes surtout... C'est à ceux-là que s'opposait le plus sa nature affamée d'absolu, et il les attaquait avec violence. « Malheur à vous, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes que vos pères ont fait mourir. Vous témoignez assez par là que vous consentez aux actions de vos pères ; car ils les ont fait mourir, et vous bâtissez leurs tombeaux. » Il bataillait à visage découvert, sans se réserver d'appuis, sans ménager personne ; et il préparait contre soi des rancunes solides.
On exploitait ses violences. On rappelait que certains politiciens assouplis avaient été exaltés à vingt ans. Quelle dérision ! La Révolution, lorsque Jean vint à elle, était vaincue et proscrite, et s'il frappait ses serviteurs infidèles ou médiocres, ce n'était que pour la mieux servir, et par amour des peuples assassinés. Qu'avait-il à gagner, aux heures où il criait sa solidarité avec des hommes menacés d'inculpations capitales, à jeter son nom aux Giboyer de l'impérialisme d'affaires, toujours prêts à salir ce qui est beau et pur? Il n'a pas craint cette salissure et il s'est, en effet, mis en avant, chaque fois qu'il s'agissait de soutenir ses amis diffamés ; Guilbeaux, Desprès, il les a défendus avec une ténacité acharnée, comme il devait se défendre, douze jours durant, contre la mort.
**
Moi qui ai aussi donné de la lumière à des humains, pendant que mon coeur se débattait dans l'angoisse et l'incertitude.
Jean DE SAINT-PRIX.
Et il a écrit pareillement : « J'étais faible, et j'ai lutté comme si j'étais fort. »
J'ai parlé de lui. J'ai dit qu'il fut grand et héroïque. Je n'ai rien dit encore. Je n'ai parlé que de ce qu'il eut de plus apparent. Sa grandeur, son héroïsme, les voici.
On a cru voir en lui un jeune homme ardent et sans trouble, que son enthousiasme portait ; on l'a loué de sa foi généreuse que ne traversait aucun doute, et de sa confiance en la vie. Il a vécu avec la mort, il a aimé la mort, et il fut désespéré. Et, c'est avec cela en lui qu'il a lutté, sans un frémissement du visage.
Il n'y a pas de contradiction, mais deux états entre lesquels il a oscillé, qu'il a souvent unis dans une tension simultanée.
Sa vraie lutte est ici ; sa lutte première et fondamentale, celle qui a permis, conditionné, passionné dans son atmosphère grandiose et terrible l'autre lutte, celle que l'on connaît, celle qu'il mena, sans se souvenir de soi et sans trembler, contre le dehors. Cette part secrète de son être, cette part qui n'est qu'une longue douleur saignante et l'âme tragique de son âme, je l'effleurerai seulement, avec toute ma tendresse et toute ma piété ; il n'appartient qu'à lui de révéler ce qui peut en être dit aux hommes : dans le recueil de ses écrits, de ses admirables lettres, ceux qui peuvent comprendre retrouveront sa belle essence ; mais, à cause de ma piété même, à cause de la vérité, je dois entrer dans ce secret.
La vérité. La voilà nommée, celle qui l'a fait si grand et qui l'a tué peut-être.
La vérité est ce que l'on n'accepte pas de l'extérieur comme un apport imposé et subi, elle est ce qui fait partie si intégrante de l'être, qu'en l'affirmant on s'affirme soi-même et que l'on ne pourrait le renoncer qu'en détruisant et en niant sa propre existence. Tous les hommes n'ont pas un égal besoin de vérité, ils ne sont pas également scrupuleux envers cette substance de leur être. Celui-ci ne subit jamais. La conviction, qu'elle lui soit proposée par d'autres ou qu'elle vienne de lui, il ne l'accepte que s'il peut la réclamer tout entière pour sienne, que s'il l'a éprouvée et s'il peut la confesser entièrement. Son aspiration vers l'absolu sera satisfaite ici ; il sera absolument sincère.
Il s'applique donc à faire en soi table rase. Mais non pas avec un détachement cartésien ; à peine peut-on dire que cette attitude soit une critique, tant elle est perpétuellement sous-tendue par une volonté d'aboutir, par une impatience constructive ; et ce n'est pas davantage une besogne une fois faite et que l'on ne recommence plus. C'est une inquiétude permanente et qui pénètre l'ensemble de la vie, affective comme cérébrale, - ou plutôt qui est déjà l'unité même de la vie, car les compartimentages n'ont guère de sens devant cette âme livrée frissonnante à tout le mystère orageux de l'existence, et assez puissante pour ne jamais se refuser au sphinx, pour vouloir au contraire étreindre, contenir tout ce mystère.
Seulement l'amour aussi le possède, n'accepte pas d'être différé, le presse d'agir... Alors, le voilà, ce jeune homme que l'on imaginait porté par les illusions, ce jeune homme qui allait avec sa confiance naïve, droit devant lui, sans soupçonner les obstacles, sans trouble! Entre les deux forces qui le déchirent, que fera-t-il ? 11 ne choisira pas. Mais nous, nous ne verrons que son action ardente, sereine, droit devant lui en effet, nous ne saurons pas qu'elle est le dénouement provisoire d'un drame qui renaît sans cesse et qui l'épuise, et qu'il nous cache, parce qu'il estime que l'individu n'a pas le droit d'affaiblir les autres hommes, proies eux-mêmes de leurs propres sphinx, avec la confidence de ses lassitudes et de ses faiblesses. Oui, découvrant la somme et l'âpreté des douleurs ininterrompues que son sourire couvrait, connaissant que tout ce qu'il nous donna, tout ce qu'il donna à l'action était un triomphe encore saignant sur lui-même et qu'il lui fallait toujours reconquérir par de nouveaux combats, je dis que cet enfant de vingt-deux ans fut un héros.
On serait .tenté de fixer des périodes aux alternatives de sa lutte intérieure. Je crois aussi que dans les derniers mois de 1917 et les premiers de 1918, sa température morale fut à son point le plus haut et le plus favorable, et qu'une dépression y succéda qui a pu amollir jusqu'à sa résistance physique. Mais, c'est une vue grossière. Même ses heures de foi, il les a chèrement achetées, et même au fond du désespoir, il n'a pas cessé de lutter. Quand la mort l'a saisi, il s'est raidi contre elle, ainsi qu'il l'avait rêvé et écrit plus d'une année auparavant, à l'extrême limite de son énergie, et il ne s'est pas rendu.
La mort, qui avait toujours été présente à sa pensée, qui toujours disait le dernier mot, la grande, l'unique victorieuse... Il a composé en face d'elle des pages d'une vérité frénétique, d'un courage sur soi qui est atroce. Je songe à l'âge où elle nous l'a pris, et je ne puis m'arrêter ici plus longtemps. La mort, contre qui, cependant, sa rébellion ressuscitait toujours... Je songe aussi aux malheureux qui ont parlé du dilettantisme anarchiste de ce jeune bourgeois, et aux hommes qui ont voulu la guerre, à la guerre qui a déchaîné en lui toute la tempête. Il a écrit qu'il était faible. Qui de nous aurait supporté cette tempête avec une égale force d'âme ?
Mais l'existence n'est pas tout. Le jour de la mort viendra tôt ou tard. Comme moi, espère dans le grand repos. La certitude de sa venue est la seule chose rassérénante.
Jean DE SAINT-PRIX.
Il n'y a pas que la tempête. Un enfant en qui tressaillaient d'aussi poignantes virtualités, l'horrible veillissement de cette guerre le charge d'une expérience plus pesante que n'auraient fait cinquante années d'âge. Jean de Saint-Prix à vingt-deux ans est semblable au vieux Tolstoï fuyant ses abîmes intérieurs à travers les steppes de Russie. Toutes les espérances se sont flétries entre ses mains, et il aspire à la mort.
Certes, tout son être demeure substance d'amour. Il ne nous a jamais reniés, il n'a jamais renié l'humanité en croix, il n'a jamais renié la lutte. Mais toutes ses interrogations se brisent aux murs de sa prison terrestre, et retombent dans son coeur affamé de certitude comme des ironies désolées.
Je ne blasphémerai pas contre lui. Je crois qu'il y avait en lui tant de grandeur que le grand souvenir qu'il nous a laissé est peu de chose en regard de ce que la mort nous a volé. Je crois que l'habitude de la bataille et de la souffrance n'aurait rien retiré à sa puissance d'aimer, mais qu'elle l'eût cuirassé contre lui-même, comme il l'était déjà contre les incompréhensions et les déceptions extérieures ; et à cause de sa vaillance et de ce qu'il eut d'Ariel, je crois que, de retours en retours, le rude apaisement que porte avec soi la fatigue même de la lutte se serait répandu en lui. Mais, il est vrai que lorsqu'il nous quitta, c'était un temps accablé et obscur. Et il est vrai aussi pour nous que sa mort a paru justifier son plus profond désespoir ; nous sommes plusieurs qui, étourdis sous le coup, n'avons plus alors retrouvé de sens à la vie. Jean n'est plus parmi nous. Il ne sera plus ici pour nous. D'où reviendra notre lumière ?
Et cela reste vrai. Pour notre peine sans consolation, ce qui fut son être, l'être réel que nous avons aimé, est tout entier à présent disparu. Mais ta mémoire, ami aérien, n'est pas cette chose morte, arrêtée à jamais, immobile derrière la porte d'un tombeau. La pierre que l'on ne soulève pas ne fermera non plus mon adieu. Je serais infidèle à sa lutte héroïque en ne saluant que le néant, et il y eut assez d'amour en lui pour qu'il soit aujourd'hui un peu vainqueur de la mort. Avant de rentrer dans le combat qui fut le sien, j'achèverai cet adieu sur des paroles sereines.
Il a cru sans espérance, oui. C'est ainsi qu'il faut croire ; dans l'œuvre à laquelle il donnait sa vie, nous ne travaillons pas pour un salaire. Il a cru ; j'ai dit dans quel perpétuel et cruel enfantement mais une valeur qu'il n'a jamais mise en doute, c'est la valeur de l'effort humain. Alors que tout se dérobait, ce point d'appui, qui n'est pas formel, qui est l'honneur de l'esprit de l'homme ce dur point d'appui demeurait et ne vacillait pas. Le monde humain, perdu dans l'espace et dans le déroulement des âges, a pu rester pour lui une barbare énigme ; que cette énigme fût insoluble, il le savait, il en était déchiré, il ne s'y résignait pas. Et il croyait en la grandeur d'être irrésigné, et il croyait en la bienfaisante grandeur, en la vertu divine des îlots que sont ces irrésignés épars dans l'océan sans rives. Cette croyance n'est pas une foi pour les lâches, mais, quand même elle a le néant pour mot suprême elle est une foi, elle est le contraire de l'abdication.
A vingt-deux ans, il laisse une oeuvre de force. Elle sera publiée. En elle-même, et parce qu'elle n'est que l'expression de l'oeuvre profonde que fut son âme elle sera pour nous tous et pour l'homme de demain, un témoignage et un exemple. Jeunes hommes de la bourgeoisie qui hésitez au carrefour, l'image de celui qui était né parmi vous peut aider à votre choix ; bien peu oseront prendre sa route, mais nous aurons confiance en ceux qui le suivront, qui n'auront pas peur de la vérité qu'il a dite ; et en cette vérité il y a aussi de la joie. Jeunes hommes du peuple, comme eux vous avez à apprendre de celui qui aima la vérité et la justice bien plus que sa vie ; il était sans vanité et sans ambition, mais il voulait servir. Il a servi, et il est mort « vivant », ainsi qu'il l'avait souhaité.
« Comme moi, espère dans le grand repos. » J'ai dit qu'il avait aspiré à la mort. Plus je me penche vers lui, plus s'impose à moi l'étrange sensation de reparcourir l'expérience d'une longue vie. La mort, le sommeil après la tâche faite, nous devons y songer aussi, nous devons l'aimer aussi ; cela aussi est une pensée bienfaisante aux forts. Lui, il avait tellement rempli sa vie dans ces cinq années de la guerre, que, peut-être, en effet, elle était une longue vie. Voici maintenant devant nous, tout près, le temps des revanches humaines qu'il appelait. Ami, nous te saluons sur le seuil ; ta pensée tout entière est vivante en nous. Comme toi, pour les luttes de la vie nous croyons en l'homme, nous ne croyons qu'en lui; et nous n'épargnerons pas notre effort ; car, comme toi aussi, ami, ami bien-aimé entré avant nous dans le grand repos, comme toi aussi nous espérons.
Marcel MARTINET.
« S'il n'y avait pas une fatalité d'idéal dans les âmes, comment n'abdiqueraient-elles pas devant la fatalité de la nature ? »
Jean DE SAINT-PRIX.
Dans la perspective du souvenir, il vit par le rayonnement de son intelligence. Il l'avait réalisée tout entière, dès son enfance, comme ces ciels tropicaux qui, sans connaître les crépuscules, possèdent d'un seul coup tout le soleil. Ainsi, il s'est éteint brusquement, sans laisser derrière lui ces longues lueurs de nos climats, mais ceux qui l'ont connu à son zénith ne pourront pas l'oublier.
Il vivait dans un flamboiement. L'intelligence en lui n'était pas cette desséchante aptitude à l'abstraction qui est une forme du nihilisme mental ; elle ne s'abaissait pas non plus au pragmatisme quotidien, aux adaptations à la matière qui ne sont que les ruses de l'instinct. Mais, ayant compris toute la vie, il en avait assumé, sans réticence, toute la charge et, tout entier, il s'était voué à elle. Ainsi, il réalisait cette « fatalité d'idéal », grâce à laquelle il n'a pas abdiqué devant les « fatalités de la nature ».
Il savait qu'à lutter contre ces fatalités, l'homme acquiert la dignité d'homme ; il savait que l'asservissement de la matière est la première étape de la libération de l'esprit et qu'à l'accomplissement de cette étape, la société capitaliste, la société militariste, la société théocratique oppose devant la marche des hommes l'encombrement brutal et meurtrier de ses richesses, de ses patries et de ses dieux. Il savait que l'homme peut s'affranchir de ces barrières, et ce n'est point sentimentalement, par simple pitié, mais, consciemment, avec toute la lucidité de son intelligence et la logique honnête que lui imposait sa lucidité que Jean de Saint-Prix était révolutionnaire.
Il savait, lui qu'auraient pu tenter toutes les joies de la contemplation, les fleurs et les musiques de l'art, que ces jouissances supérieures de l'humanité ne sont possibles désormais qu'au prix de la plus douloureuse délivrance et que nos générations volontaires doivent être le ferment dont s'éclora le monde nouveau. Et c'est pourquoi, sans mentir à sa destinée par aucune complaisance, il s'est jeté dans la lutte, devançant ses aînés, manifestant pour nous, qu'arrêtait l'hésitation ou la lassitude, notre conscience même et le hautain devoir, dont sa mort nous a fait le legs impérieux et l'inconsolable abandon.
Joseph Bluter.
JEAN DE SAINT-PRIX
Dans la solitude de sa conscience et de son coeur, sa pensée avait mûri lentement et quand il vint vers nous, avec l'ardeur de ses vingt ans, il était déjà des nôtres, depuis longtemps. Mais tandis que la guerre, chez d'autres, détruisit toute foi en l'avenir humain, lui, sut résister à la funeste contagion de la bêtise et de la férocité. Il garda intactes ses idées reniées, bafouées, par tant d'intellectuels et de militants qui, du jour au lendemain, s'étaient transformés en foudres de guerre. Il assista, l'âme déchirée, au spectacle lamentable des reniements et des trahisons.
Au cours d'un voyage en Suisse, il vit Romain Rolland et ses amis, petit groupe d'écrivains demeurés fidèles à la cause sacrée de l'humanité, pacifistes, déterminés et internationalistes convaincus: Il trouva près d'eux un précieux réconfort. Désormais, il se sentit moins seul.
Je le revois, se présentant à nous, les yeux clairs, l'air doux et pensif, la main cordialement tendue. Dès l'abord, on comprenait qu'on avait devant soi un être d'une intelligence exceptionnelle, d'une sensibilité rare. Il n'était pas nécessaire d'échanger beaucoup de paroles pour confirmer le profond accord de nos sentiments et de nos pensées.
En ces jours sombres, la guerre stupide, démesurément meurtrière, opprimait les consciences probes. Les masses populaires, abusées par une presse servile et vénale, prenaient parti pour le nationalisme et l'impérialisme des gouvernants. Les esprits indépendants étaient condamnés au silence ignominieux. La civilisation s'effondrait sans qu'on pût lui porter secours. L'Europe se suicidait. Un prompt rétablissement de la paix seul la pouvait encore sauver. Mais comment mettre fin à l'assassinat monstrueux et systématique? Ces préoccupations nous obsédaient douloureusement.
Quelles heures d'angoisse nous vécûmes ? Et quelles colères grondèrent en nous! Les fous et les criminels triomphaient en tous pays. Au printemps 1918, nous disposâmes enfin d'une tribune libre, la Plèbe, et nous pûmes exposer, à. coeur ouvert et sans crainte, nos opinions antiguerrières. Jean de Saint-Prix fut un collaborateur talentueux et combatif. Mais, la censure mutila ou supprima la majeure partie de ses articles. Et bientôt, d'ailleurs, MM. Mandel et Clemenceau, adversaires de toute contradiction, supprimèrent le journal qu'ils trouvaient trop vivant. Etre vivant, c'est un crime que ne pardonnent pas ceux qui, pour des conquêtes de territoires, pour de nouveaux marchés ou la vaine gloire du triomphe militaire, n'hésitent pas à mettre le monde à feu et à sang et à peupler les tombeaux.
Jean de Saint-Prix était un vivant dans toute la force du terme. Nul plus que lui n'aimait la vie et ce qui lui donne son véritable prix : la liberté. Tout ce qui comprime, entrave et détruit la vie lui apparaissait comme un blasphème.
Il abhorrait la guerre et l'ordre social qui l'engendre. Des effets, il remontait lucidement aux causes. La solution qui s'imposait, impérieuse, à son esprit : la révolution, il l'appelait de tous ses voeux.
Il admirait la puissance du mouvement révolutionnaire russe et tenait en haute estime ses créateurs : Lénine, Trotsky, Lunatscharsky, Gorky, et le grand peuple idéaliste qui chassa ses tyrans et réalisa la justice sociale.
Par contre, il souffrait vivement de la dépendance des peuples en proie au vertige guerrier, trompés par leurs bergers, et l'isolement moral de la classe paysanne l'inquiétait comme une menace pour toute la famille humaine.
Il était frémissant de révolte devant toute injustice. Il avait le culte de l'amitié. Il plaçait la vérité au-dessus de tout. Il était toute flamme, toute pureté, toute grandeur.
Nous l'aimions comme un frère, et comme un compagnon de lutte parfait. Nous étions sûrs de son coeur solidaire et fraternel. Il savait de son côté, combien nous lui étions attachés. Personnellement, je garderai l'impérissable souvenir de la spontanéité du geste de défense qu'il accomplit en ma faveur à l'heure où, frappé par un gouvernement de forbans, je ne pouvais — étant dans les fers — riposter aux insultes d'une presse policière.
Cet enfant avait en lui tous les courages, toutes les audaces, tous les dévouements. Grand travailleur, il assumait vaillamment des tâches de longue, haleine.
... Avec quelle joie, je le revis, quelques mois plus tard, dans le Bourbonnais, chez Marcel Martinet, autre pur parmi les purs ! Promenades, causeries, brèves heures inoubliables !
Et la mort, sournoisement, foudroya cette noble intelligence. Ce fut l'unique chagrin que nous causa Jean de Saint-Prix, mais ce chagrin durera autant que nous. Notre petit groupe d'esprits fiers et libres a perdu le meilleur des siens.
Nous savons que la perte d'un tel homme est une calamité pour l'humanité entière. Sa vie était consacrée à la défense des opprimés. Il laisse, aux jeunes hommes, un exemple incomparable. Son jeune frère, qui partage sa foi, a, lui aussi, une âme vaillante éprise de vérité et de justice. Il sera fidèle à la grande mémoire de son aîné. Il appartient à la jeunesse frémissante qui sauvera le monde. Qu'il soit assuré ici de notre profonde affection.
Fernand DESPRÈS.
Paris fleuri de Rouge
Peuple de Paris fleuri de rouge ! Peuple de Paris, tu as retrouvé ton sang. Ce n'était pas seulement une protestation contre le crime et l'injustice des juges couvrant le crime. Qui donc pensait à Villain, qui se souvenait des douze haineux imbéciles qui, n'osant le féliciter, épanouirent pourtant sur lui, pour le couvrir, l'ordure de leur âme bourgeoise.
Plus haut fut ton verdict, peuple de Paris ! Dans cette rouge journée d'avril, dans cette journée de mort et de résurrection, je pensais au symbole éternel. Tant de sang répandu, depuis le sang de Jaurès, premier martyr, victime individuelle d'une brute déléguée par les nourrisseurs de Moloch, victime nécessaire pour que fût possible le sacrifice, jusqu'au sang des millions d'humains, versé pour l'unique tentative de cimenter les blocs d'une Bastille sociale effritée et pourrie, écrasée sous le poids des coffres-forts ; tout ce sang fleurissait dimanche aux battements graves et lourds des rouges drapeaux déployés, au rythme des coeurs populaires ; il fleurissait aux paroles des hymnes et dans les yeux et sur les joues des enfants et des femmes, comme il fleurissait les corsages et les boutonnières — et jusqu'à celles — ô ironie ! — des mouchards blêmes et honteux, embellis, pour un jour, d'en être éclaboussés.
Symbole de l'éternel retour ! Fête de la mort au printemps, où dans l'amour des morts, la vie puise la force de renaître (1). Nous avons célébré nos morts, tous nos morts, dont les assassins en liberté peuplent les villes, depuis les caveaux où se tripotent de misérables convoitises, jusqu'aux palais dorés des potentats, en passant par les lupanars académiques, les états-majors et les salons, les banques, les parlements, les secrétariats de comités, de syndicats et de partis et les officines malpropres où les mains corrompues se nouent autour du sac aux trente deniers.
Haceldama ! Champ de sang ! Champ inculte et sinistre, acquis au prix du sang d'un juste et de millions d'innocents, champ immense et dévasté de l'Europe ! Voici que de l'Orient à l'Occident tes nouveaux maîtres épouvantés voient lever de ton sol obscur une étonnante moisson rutilante. Il semble que la terre outragée dégorge le sang qu'elle a reçu, le sang de ses enfants inutilement massacrés, force à jamais perdue dont elle refuse l'hommage. Et la vague déferle sur les collines, comble les ravins, franchit les frontières, fraternité des hommes cruellement retrouvée dans l'égalité de la mort.
(1) C'est le thème de l'admirable Chant de Midi, de Georges CHENNEVIÈRES et Albert DOYEN.
Hommes qui durant quatre ans vous êtes massacrés sans vous connaître ! Frères ! votre sang ennemi s'est confondu au sein de la mère et le voici qui sourd et nous soulève, et c'est lui qui porte la vie, en ce printemps, à nos drapeaux, à, nos chansons, aux joies et aux regards de nos enfants.
Europe ! Europe ! Femelle écartelée, livrée aux bêtes ! Les plus forts de tes fils et les plus innocents sont morts pour que la Révolution soit impossible. Et nous restons, les blessés, les débiles, les désabusés de trop d'espoirs, les forçats déjà fatigués de la pensée, nous restons, attentifs et fidèles, et c'est ton sang, Jaurès, c'est votre sang, ô morts, qui nous ranime et qui revit en nous, pour que la Révolution soit faite !
Alors s'apaisera ce battement fiévreux du cœur, universel, cette souffrance lancinante, cette objurgation impérieuse qui est votre ordre, votre parole : l'ordre nouveau de la justice, la parole qui doit animer l'humanité. Et le sang apaisé, avec nos vies offertes, retournant à la terre, unie en ses provinces comme en la continuité des saisons — mais brandi sur nos têtes, éternel souvenir des martyrs, commémoré dans le drapeau rouge — fleurira désormais les fêtes du printemps et les visages de nos fils — coquelicots parmi les blés — d'une couleur de joie et de triomphante confiance.
Joseph BILLIET.
Les bienfaits du patron, même le meilleur, ne réussissent pas à satisfaire l'ouvrier ; d'abord parce qu'ils lui sont dévolus à titre de munificence, de charité et non de justice ; ensuite parce qu'il peut en perdre le bénéfice en même temps que ses moyens journaliers de subsistance par le fait d'un renvoi arbitraire auquel il est à tout instant exposé.
Mgr BAUDRILLART.
(Discours à l'Académie Française.)
.* *
Il a travaillé trente ans, il a commencé quand la fabrique n'occupait que deux corps de bâtiment, et, aujourd'hui, elle en a sept ! Les fabriques se développent et les gens meurent en travaillant pour elles...
(La Mère.) Maxime GORKI.
L'abondance des matières nous oblige, malgré les quatre pages supplémentaires dont est augmenté ce numéro, à renvoyer au prochain numéro plusieurs articles, parmi lesquels une assez longue étude de LUIGI FABBRI sur le Problème de l'Etat et la Guerre, La Classe paysanne, d'A. CROIX, L'Outil de l Internationale, de HUBERTO FÉREZ, etc.
MOUVEMENT INTERNATIONAL
FRANCE
Deux faits importants, ce mois-ci : le Congrès national socialiste, et la manifestation du 1er mai,
L'impression qui se dégage du Congrès socialiste est une impression d'hésitation, d'irrésolution, de désorientation,- peut-être aussi, et surtout, de timidité.
Tout d'abord, on avait cru nécessaire d'élaborer deux programmes : un programme électoral et un programme d'action générale, le premier, sorte d'édulcoration du second.
Méthode assez déconcertante et qui semble signifier que, dans l'esprit de ceux qui y avaient recours, il y a, deux manières de concevoir l'action socialiste : l'une, lénifiée, expurgée, et bénigne, bénigne, bénigne, à l'usage des électeurs — à qui, en l'occurrence, elle serait alors offerte comme une sorte d'attrape-nigaud ; l'autre, plus accentuée, plus énergique, mais qui serait reléguée à l'arrière-plan des conceptions purement théoriques.
Ce manque de franchise dans l'allure qui admet, somme toute, deux vérités, l'une mitigée, l'autre entière mais d'un usage occasionnel et intermittent, fut une cause de division au sein du Congrès, et un gros obstacle. à une conclusion ferme, claire, significative de cohésion et de volonté résolue.
La question de la troisième Internationale, elle aussi, eut une solution hybride, ni chair ni poisson. On ne repoussa pas l'idée d'adhérer à la troisième Internationale, mais après avoir tenté de tirer de la deuxième le bien que, hélas ! on en a attendu en vain pendant la guerre. L'expérience n'est pas concluante, paraît-il. Et les dirigeants de la deuxieme Internationale chez qui, au moment de la crise, depuis si longtemps prévue par tous les socialistes et les révolutionnaires, du heurt sanglant des appétits capitalistes, l'empreinte nationaliste prima la foi internationaliste précédemment professée, peuvent encore faire illusion et donner à certains un espoir quelconque en une conduite plus éclairée, plus conforme aux principes tant de fois affirmés !
La majorité du Congrès a décidé de continuer à traîner ce poids mort qui paralyse. son action. Et cela au moment où la Révolution gronde partout, où ses premières secousses se .répercutent jusque chez nous ! Quand, plus que jamais, il importe de faire montre d'esprit de décision et d'organisation !
Le 1er mai 1919 marquera dans l'histoire comme une des premières et des plus éclatantes démonstrations de force set de solidarité du Prolétariat. Le chômage — soit total, soit. momentané — qui avait été décidé, fut intégralement observé. Le prolétariat a pu se convaincre que, quand il le voudra, il tiendra la bourgeoisie à son entière merci.
Il lui reste, maintenant, à acquérir la confiance en soi pour sa substitution à la bourgeoisie, dans l'organisation et l'administration de la production des échanges, et de la répartition.
Que partout les groupes producteurs s'enquièrent des conditions économiques de leurs régions respectives, des disponibilités en matières premières, en matériel, en outillage, en moyens de transports, enfin de tout ce qu'il importe de connaître pour organiser la vie sociale d'un pays, et ils seront prêts à prendre en main l'administration économique de la société et à. la faire fonctionner au profit de tous.
Telle est l'ouvre urgente qui s'impose dès maintenant aux syndicats, et surtout aux Comités intersyndicaux, dont il importe de multiplier le nombre au maximum ; parce que, groupant localement des métiers, des industries diverses, ils sont plus aptes que d'autres groupements unicorporatifs à élaborer une organisation d'ensemble, coordonnée dans ses détails.
L'après-midi du 1er mai a été transformée, par le gouvernement du sinistre vieillard, jaloux des lauriers de Thiers, en une admirable tuerie.
Clemenceau est content, bien content ; il fait la guerre...
Jules Vallès qui le connaissait bien, pour l'avoir intimement fréquenté jadis au Quartier-Latin, disait de lui :
"Clemenceau finira dans le sang du peuple."
Dans le sang des peuples est plus exact.
CONDITIONS D'ABONNEMENT
France, 6 numéros_ ……….. Fr. 2,50
- 12 numéros ... .... ..... 4 »
- 24 numéros ……….. 7 »
Etranger, 12 numéros ………… 7 »
- 24 numéros …………. 12 »
Adresser mandats, mandats-cartes ou timbres-poste au camarade HASFELD, à L'Avenir International, 96, quai Jemmapes, Paris.
Le Gérant : André GIRARD.
Imprimerie LA PRODUCTRICE (Ass. Ouv.), 51. rue St-Sauveur. Paris.
Téléphone : Gutenberg 21-78. — E. LANDRIN, admin.-délégué.